Celtes en Corse
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 21/12/2005 à 06h46
1205 vues
Question d'origine :
la présence des Celtes en Corse est-elle attestée?
Réponse du Guichet
Le 22/12/2005 à 15h19
L'ensemble des peuples parlant une langue indo-européenne, individualisés vers le IIe millénaire et qui occupèrent une grande partie de l'Europe ancienne. Sans doute issus du sud-ouest de l'Allemagne, les Celtes émigrèrent en Gaule à l'époque de Hallstatt (900-450 av. J-C) puis en Espagne (Celtibères), en Italie, dans les Balkans et en Asie Mineure (sous le nom de Galates) à l'époque de La Tène (Ve s.-Ier s. av. J-C). Ils s'établirent également dès le Ier millénaire, dans les îles britanniques. Les Germains puis les Romains (IIIe-Ier s. av. J-C) détruisirent la puissance celtique ; seuls subsistèrent les royaumes d'Irlande.
Source : Le Petit Larousse illustré 2003
Apparemment, rien ne permet, dans les documents que nous avons consultés, d'attester d'une présence significative des Celtes en Corse.
Extraits :
"Histoire de la Corse" de Paul Arrighi et Francis Pomponi (2003)
Le problème des origines de l'occupation humaine de la Corse a souvent pesé dans les interrogations que les insulaires se sont posées en se tournant vers leur passé et cette curiosité a parfois été liée à des préoccupations que ne conduisait point une démarche purement scientifique ; ainsi en allait-il au temps où certains partaient à la recherche justificative du concept de race corse.
Alors que la prudence est de règle à propos du paléolithique dont on n'a point trouvé de traces attestant la présence de l'homme dans les îles méditerranéennes (à l'exception de la Sicile), il est dès lors bien établi que l'homme a fait son apparition en Corse avant même le néolithique.
C'est par la voie maritime et plus précisément par l'archipel toscan - une quarantaine seulement de kilomètres séparant à cette époque la Corse de l'Italie péninsulaire par suite de la dernière oscillation du niveau de la mer - que les premiers hommes ont dû s'installer en Corse.
A la fin du néolithique, voire peut-être seulement au chalcolithique, fait son apparition le phénomène mégalithique dont certaines formes constituent la grande originalité insulaire par rapport à l'environnement des îles méditerranéennes. Cette originalité ne provient point tellement de quelques beaux spécimens de dolmens précédés dans le temps par des tombes à coffre mais de la présence de statues menhirs, fréquentes certes sur le continent mais qui ne se retrouvent dans aucune autre île de la Méditerranée. 70 menhirs à ce jour ont été repérés et inventoriés et le site le plus impressionnant à cet égard reste celui de Pagliaiu, près de Sartène, où se trouve le plus dense alignement. Ces pierres anthropomorphes ont excité l'imagination populaire qui les a intégrées dans des cycles légendaires ou mythiques.
Pour expliquer le fait mégalithique point n'est besoin d'avoir recours à l'hypothèse de la venue de « missionnaires » qui auraient introduit dans l'île une religion et des pratiques cultuelles nouvelles ; on pense plutôt à une évolution autochtone qui s'est développée au sein du peuplement existant.
[...]
La principale originalité consiste dans l'apparition vers le milieu du IIe millénaire de menhirs anthropomorphes qui portent gravée la représentation d'armes, poignards ou épées dont les formes confirment la datation. Grosjean en a établi un classement stylistique qui ne traduit pas forcément les étapes d'une évolution linéaire. On remarque que ce bel ensemble de mégalithes est concentré dans le Sartenais sans qu'on puisse vraiment en donner une explication.
[...]
Les "torre" qui ont leur originalité propre sont à la Corse ce que les "nuraghi" sont à la Sardaigne et les "talayots" aux Baléares. Établissant une corrélation entre les menhirs armés et les constructions torréennés Grosjean a échafaudé l'hypothèse d'une invasion de la Corse par le sud par un des peuples de la mer les Shardanes, qui auraient introduit ce nouveau type d'habitat défensif en combattant contre les indigènes.
On tend plutôt aujourd'hui à marquer la filiation locale entre l'habitat du néolithique récent et celui de l'âge du bronze ou bien, si l'on admet l'arrivée d'envahisseurs, on situe leur incursion au XVe ou au XIVe siècle ces nouveaux venus auraient introduit en Corse la culture de l'âge du bronze moyen, mais on se garde d'interprétations ou de comparaisons hasardeuses.
De vastes zones d'ombre demeurent et elles s'épaississent en plein âge du fer pour lequel nous disposons encore de peu d'éléments d'informations encore que des chercheurs tendent actuellement à «réhabiliter» cette période.
[...]
II faut attendre le VIe siècle av. J.-C. pour voir la Corse entrer dans l'ère historique dont les témoignages écrits viennent étayer les découvertes archéologiques. Jusque-là on dispose bien de quelques allusions rétrospectives concernant des déplacements de populations tels l'arrivée de Libyens, d'Ibères ou de Ligures dans l'île ou inversement le départ de Corses qui seraient aller fonder Populonia en Étrurie, mais l'imprécision, le caractère mythique et l'absence de confirmation par les fouilles de ces brassages invitent à la prudence. Par contre, il est certain que dès 560 mais surtout vers 540, le pays a été touché par le large mouvement de la colonisation grecque qui s'est développé d'est en ouest dans le bassin méditerranéen.
La pénétration des Romains en Corse se fit à l'occasion de la première guerre punique qui les opposa aux Carthaginois.
Voir aussi : Corse : écologie, économie, art, littérature, langue, histoire, traditions populaires
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




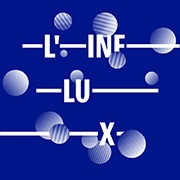 Pilote sacrifié
Pilote sacrifié