Question d'origine :
J’ai trouvé deux avis différents
1/ FUTURA SCIENCE a publié un article
« Quelle est l’origine de l’horlogerie suisse ?»
https://www.futura-sciences.com/science ... uisse--%5D
Les horlogers suisses seraient des orfèvres au chômage suite aux injonctions de Calvin condamnant l’ostentatoire
Ils se seraient recyclés dans l’horlogerie
2/
Dans le livre « l’heure qu’il est » David S Landes éditions Gallimard celui-ci indique : la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 mettant à mal la politique économique de Colbert
« Parmi les réfugiés qui vinrent à Genève se trouvait des horlogers fuyant la France ou les protestants formaient l’élite de la profession. Ils installèrent dans une ville qui s’était jadis glorifié de posséder une puissant manufacture de joaillerie brisée par la passion religieuse : Jean Calvin n’avait que faire des ornements et des vanités mais ce même régime puritain qui condamné la joaillerie était disposé à faire une exception pour les montres » § 15 multum in parvo
Ils ont trouvé les orfèvres Suisse de Genève au chômage. Suite aux instructions de Calvin Ceux-ci se sont convertis à l’horlogerie
Parmi ces horlogers français protestants :
• · LeCoultre originaire de Seine et Marne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaeger-LeCoultre)
· Nicolas Bouquet il quitta Lyon pour Genève puis Londres après la révocation de l’Edit de Nantes
Quelle est la position du Guichet du Savoir ?
D’avance Merci
Réponse du Guichet
Le 11/01/2018 à 15h44
Bonjour,
Selon Patrick Pigon et Paul Guichonnet, dans leur article Genève publié dans l’Encyclopaedia Universalis en ligne, dans la section « L'affirmation du rôle international (1603-1798) » de l'article, « après la grave récession qui suit la disparition des foires, Genève devient l'un des plus grands centres européens d'accumulation de richesses. Au-delà de son environnement proche, la cité tisse un réseau de relations lointaines. La révocation de l'édit de Nantes (1685) lui vaut le nouvel apport de population française du « second refuge », mais l'accroissement démographique est lent et on ne dénombre encore que 26 140 habitants en 1789. Des cessions et des échanges avec la France (traité de Paris, 1749) et avec la Sardaigne (traité de Turin, 1754) agrandissent un peu le territoire de la république qui met en œuvre une vigilante politique de subsistances, par la création de la Chambre des blés et la pratique d'une agriculture intensive. Elle cherche, pour sa main-d'œuvre, une activité à haut rendement, élaborant des matières premières nobles et peu volumineuses. L'horlogerie, apportée par des réfugiés français, répond à ces conditions et la Fabrique, qui ne cesse de prospérer, compte, en 1786, 6 000 « cabinotiers »."
Selon l’histoire de l’horlgerie retracée sur le site de la Fondation de la Haute Horlogerie, les premiers horlogers de Genève sont en majorité « d’origine française et réfugiés pour cause de religion » :
« 1554 - Apparition du premier « orologier » de Genève, le français Thomas Bayard, qui sera notamment suivi par Martin Duboule à la fin du XVIe siècle. […]Genève accueille des protestants venus de France et d'Italie. La présence d'horlogers à Genève est attestée par des documents d'archives (contrats d'apprentissage notariés). Pour la plupart, ils sont d'origine française et réfugiés pour cause de religion. »
Le rôle joué par les protestants d’origine française est confirmé dans l’article Histoire des montres suisses paru dans le magazine L’Histoire en 1980 :
«Le XIXe et le XXe siècle auront longtemps vécu à l'heure suisse. L'abondance de la main-d’œuvre, les bas salaires et la production en série n'expliquent pas tout : la montre était, en Suisse, l'affaire des communautés protestantes francophones. »
Eric Bruton avance la même explication dans son ouvrage qui fait référence Histoire des horloges, montres et pendules (1980) :
« Jean Calvin, propagateur en France et en Suisse de la Réforme protestante, réussit à former un gouvernement presbytérien à Genève. La ville, il est vrai, traversait alors une période difficile. Ses marchants l’avaient désertée ; l’industrie stagnait. L’accueil que reçurent les artisans protestants et les privilèges notoires dont ils jouirent s’expliquent donc aisément. Après 1550, des horlogers français réfugiés , ainsi que quelques immigrants venus d’Allemagne, des Pays-Bas et d’Italie, arrivèrent à Genève, d’autres s’établirent à Londres ». (p.62)
Pour aller plus loin :
- Le livre de la manufacture Jaeger LeCoultre (1999)
- Quand nous étions horlogers : images-portrait de mon pays / Simone Opplige (1980)
- L'heure qu'il est : les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne / David Saul Landes (1987)
- L'horlogerie: une tradition helvétique / Alfred Chapuis (1948)
Bonne journée
Selon Patrick Pigon et Paul Guichonnet, dans leur article Genève publié dans l’Encyclopaedia Universalis en ligne, dans la section « L'affirmation du rôle international (1603-1798) » de l'article, « après la grave récession qui suit la disparition des foires, Genève devient l'un des plus grands centres européens d'accumulation de richesses. Au-delà de son environnement proche, la cité tisse un réseau de relations lointaines. La révocation de l'édit de Nantes (1685) lui vaut le nouvel apport de population française du « second refuge », mais l'accroissement démographique est lent et on ne dénombre encore que 26 140 habitants en 1789. Des cessions et des échanges avec la France (traité de Paris, 1749) et avec la Sardaigne (traité de Turin, 1754) agrandissent un peu le territoire de la république qui met en œuvre une vigilante politique de subsistances, par la création de la Chambre des blés et la pratique d'une agriculture intensive. Elle cherche, pour sa main-d'œuvre, une activité à haut rendement, élaborant des matières premières nobles et peu volumineuses. L'horlogerie, apportée par des réfugiés français, répond à ces conditions et la Fabrique, qui ne cesse de prospérer, compte, en 1786, 6 000 « cabinotiers »."
Selon l’histoire de l’horlgerie retracée sur le site de la Fondation de la Haute Horlogerie, les premiers horlogers de Genève sont en majorité « d’origine française et réfugiés pour cause de religion » :
« 1554 - Apparition du premier « orologier » de Genève, le français Thomas Bayard, qui sera notamment suivi par Martin Duboule à la fin du XVIe siècle. […]Genève accueille des protestants venus de France et d'Italie. La présence d'horlogers à Genève est attestée par des documents d'archives (contrats d'apprentissage notariés). Pour la plupart, ils sont d'origine française et réfugiés pour cause de religion. »
Le rôle joué par les protestants d’origine française est confirmé dans l’article Histoire des montres suisses paru dans le magazine L’Histoire en 1980 :
«Le XIXe et le XXe siècle auront longtemps vécu à l'heure suisse. L'abondance de la main-d’œuvre, les bas salaires et la production en série n'expliquent pas tout : la montre était, en Suisse, l'affaire des communautés protestantes francophones. »
Eric Bruton avance la même explication dans son ouvrage qui fait référence Histoire des horloges, montres et pendules (1980) :
« Jean Calvin, propagateur en France et en Suisse de la Réforme protestante, réussit à former un gouvernement presbytérien à Genève. La ville, il est vrai, traversait alors une période difficile. Ses marchants l’avaient désertée ; l’industrie stagnait. L’accueil que reçurent les artisans protestants et les privilèges notoires dont ils jouirent s’expliquent donc aisément. Après 1550, des horlogers français réfugiés , ainsi que quelques immigrants venus d’Allemagne, des Pays-Bas et d’Italie, arrivèrent à Genève, d’autres s’établirent à Londres ». (p.62)
Pour aller plus loin :
- Le livre de la manufacture Jaeger LeCoultre (1999)
- Quand nous étions horlogers : images-portrait de mon pays / Simone Opplige (1980)
- L'heure qu'il est : les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne / David Saul Landes (1987)
- L'horlogerie: une tradition helvétique / Alfred Chapuis (1948)
Bonne journée
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




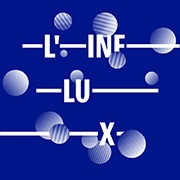 Béton : enquêtes en sables mouvants
Béton : enquêtes en sables mouvants