Question d'origine :
Bonjour,
Je me suis renseignée sur la commémoration du 40ème anniversaire de la mort d'André Malraux, dont les cendres sont au Panthéon depuis 1996.
Je me demande pourquoi André Malraux est aujourd'hui au panthéon, quel symbole cela représente pour la France ? Pourquoi André Malraux est-il considéré comme "un grand homme" ?
Plus largement, à travers le cas d'André Malraux et le transfert de ses cendres au Panthéon, j'en suis arrivée à me demander : Comment comprendre la création des grands hommes français ? Quel est le processus ?
Auriez-vous de la littérature sur ce sujet ?
Merci d'avance!
Réponse du Guichet
Le 02/01/2017 à 09h43
Bonjour,
Sur le site officiel du Panthéon, vous pourrez consulter un document qui retrace l'histoire des cérémonies d'hommage au Panthéon. En voici quelques extraits qui répondront à certaines de vos questions :
" Le culte des grands hommes est attesté déjà à l’époque de l’Antiquité dans l’œuvre de Plutarque et reprise pendant longtemps à l’époque de la royauté. Cependant, c’est au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, que la France montre un véritable engouement qui trouve son apothéose par lafondation du Panthéon le 4 avril 1791 , par décret voté à l’Assemblée nationale. Le vote stipule que, excepté Voltaire et Rousseau, seuls les grands hommes du présent étaient susceptibles d’être admis au Panthéon. L’édifice devient ainsi la nouvelle nécropole républicaine qui se substitue au cimetière des rois de la basilique de Saint Denis.
Le culte des grands hommes pendant la Révolution resterait constamment partagé entre deux types divers d’exemplarité : le philosophe, grand homme solitaire et le militaire, héros collectif et patriote. Ce n’est plus le rang de naissance qui donne droit à la reconnaissance post mortem, mais l’œuvre et les actions réalisées pendant la vie. Contrairement au roi et aux nobles, le grand homme n'héritait pas son titre, celui-ci ne lui était pas donné par Dieu, il était acquis par la réussite personnelle à travers l'effort et le travail au service de l'humanité.
[...]
Le régime présidentiel de la Vème République donne une nouvelle vigueur à la tradition des funérailles républicaines du fait de la position prédominante du chef de l'Etat qui devient à la fois le symbole et le responsable de la nation . Le président De Gaulle transfère en 1964 le corps du résistant Jean Moulin mais le Panthéon ne parvient pas à retrouver une place centrale dans la vie républicaine. Pendant plus de vingt ans, le monument est très peu entretenu et déserté, trop marqué par le souvenir de la IIIème République et des mouvements de mai 68. C'est avec Mitterrand que l'édifice redevient un lieu symbolique important. En 1981, la cérémonie d'inauguration de sa présidence, très médiatisée, inclut une visite au Panthéon. Le lieu renoue ainsi avec la tradition en redevenant un rite porteur d'une forte charge émotionnelle et d'une forte valeur
politique.
Depuis cette date, le rythme des cérémonies qui se déroulent au Panthéon a largement dépassé celui de toutes les époques précédentes. Ce phénomène s'explique avec le nouveau regard qui est porté sur l'histoire à travers les commémorations. Elles visent à légitimer la politique en place. Le monument devient sous la Vème République le symbole d'un nouvel intérêt porté sur les rituels que l'on avait cru dépassés. Le président Mitterrand fait rentrer René Cassin (1987), Jean Monnet (1988), puis Monge, Condorcet et l'abbé Grégoire (1989) ainsi que Pierre et Marie Curie (1995). Jacques Chirac continue avec André Malraux (1996) et Alexandre Dumas (2002). Le Panthéon ne subit pas uniquement une simple réutilisation mais un véritable changement et la réinvention d'un rituel.
La première rupture avec l'ancien dispositif est significative et aura des conséquences sur les aspects scéniques de la cérémonie.Le Président devient, la
personne unique à qui reviennent l'initiative et la décision des transferts au Panthéon . Le rôle principal du président a des effets immédiats sur les gestes. La foule des parlementaires sur les marches de l'édifice n'existe plus, un nouvel ordre tourne autour du chef de l'Etat. La prééminence du président se manifeste également lors des périodes de cohabitation, mais elle persiste aussi en dehors de cet aspect : en 1989 Jacques Lang prononce le discours, mais Mitterrand pénètre seul dans l'édifice sans associer le premier ministre. En 1996 Jacques Chirac est entouré de la famille d'André Malraux mais il ne laisse aucune place au ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy "
source : La cérémonie d'hommage au Panthéon
Pourquoi Jacques Chirac a-t-il décidé de faire entrer André Malraux au Panthéon ?
Tout d'abord, Olivier LE NAIRE dans Entrez au Panthéon !: A la redécouverte de l'histoire de France explique quece choix n'a pas fait l'unanimité :
" Jacques Chirac, lui, n’a jamais été un fervent admirateur du Panthéon. Cependant, il a pu constater l’usage politique qu’a su en faire son prédécesseur. Et, comme lui, il inaugurera chacun de ses deux mandats par un transfert de cendres. L’idée d’André Malraux, qui rejoint Jean Moulin dans la crypte le 23 novembre 1996, lui a été soufflée par l’ancien Premier ministre Pierre Messmer.
« Au début, Jacques Chirac, pas vraiment fan de Malraux, n’est pas très enthousiaste », se souvient Bernard Spitz, ancien conseiller de Michel Rocard et, pour sa part, inconditionnel de l’auteur de La Condition humaine. Mais lorsqu’il se rend compte que rien n’est prévu quelques mois seulement avant les vingt ans de la mort du romancier, le chef de l’Etat demande à son ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, de constituer un comité de commémoration, qui est confié à Spitz. La panthéonisation est donc préparée, maissans l’assentiment de Maryvonne de Saint-Pulgent, alors directrice du Patrimoine et très farouchement hostile au bilan du Malraux ministre . Une atmosphère polaire – au propre comme au figuré – préside donc à la cérémonie ce jour-là !"
L'article de Garcia Patrick, « Jacques Chirac au Panthéon. Le transfert des cendres d'André Malraux (23 novembre 1996) » (Sociétés & Représentations, 2/2001 (n° 12), p. 205-222) nous en dit davantage sur les raisons qui ont motivé Jacques Chirac à faire entrer André Malraux au Panthéon :
" Cependant la panthéonisation d’André Malraux représente, pour le président, uneopportunité politique . Elle est, à ce titre, suivie avec attention par Claude Chirac et la cellule de communication de l’Élysée. Du point de vue présidentiel l’entrée de Malraux au Panthéon permet, en effet, de montrer, selon l’expression de Maryvonne de Saint-Pulgent, que « la gauche n’a pas le monopole du Panthéon ». Comme le souligne Pierre Nora :
[Cette cérémonie fait] le pendant à la cérémonie d’intronisation de François Mitterrand. […] Mitterrand au Panthéon, c’était les retrouvailles de la gauche avec elle-même, le réenracinement dans une version de l’histoire de France [….]. La panthéonisation de Malraux, c’est aussi, pour Chirac, une forme de ressourcement, l’onction gaullienne
Ce ressourcement prend plusieurs formes. La plus visible est bien sûr, qu’à travers Malraux, compagnon et ministre du général, c’est le gaullisme qui entre au Panthéon – Charles de Gaulle ayant toujours refusé, pour lui-même, cet honneur. Mais le transfert des cendres de Malraux permet aussi, par-delà l’appropriation mitterrandienne, de réinvestir le Panthéon et de renouer avec le geste de 1964. C’est donc, d’une certaine manière, la reprise en main symbolique de la Ve République, après les deux septennats de François Mitterrand, qui s’effectue au soir du 26 novembre 1996.
En outre, la personnalité et l’itinéraire de Malraux sont propices à démontrer que la généalogie de la droite ne saurait être réduite au conservatisme. Sous cet angle, André Malraux,figure emblématique de l’engagement dans les combats du siècle, intellectuel, antifasciste, résistant, est précieux. La mise en valeur du patrimoine gaulliste par l’hommage rendu à Malraux est, ainsi, de nature à contribuer à (re)construire l’image du président, affectée par le mouvement social de novembre-décembre 1995, en renouant, par l’évocation de la capacité de rassemblement du gaullisme et le dépassement qu’il est censé opérer du clivage gauche/droite, avec la thématique de la campagne présidentielle et le discours dénonçant la fracture sociale. De surcroît, le personnage de Malraux lui-même est assez protéiforme pour que tous les courants politiques – à l’exception de l’extrême droite – puissent y reconnaître leurs valeurs et au-delà approuver l’éloge de l’engagement dans la vie de la cité à un moment où l’abstentionnisme semble miner les valeurs civiques.
Enfin, après François Mitterrand qui posait volontiers en intellectuel, la célébration d’un homme de lettres, à la fois auteur, collectionneur et artisan d’une politique nationale de diffusion de la culture, donne l’occasion à Jacques Chirac d’apparaître, lui aussi, comme unprésident soucieux de culture et un intellectuel . C’est sur ce point qu’insiste, non sans raison, le Sunday Times :
Il y a plus dans la résurrection de Malraux opérée par Chirac que son désir d’honorer un grand gaulliste. Dans un pays qui révère les intellectuels, le président, généralement présenté comme un homme qui aime plus la bière que les livres se sent vulnérable
L’entretien déjà cité, que Jacques Chirac accorde au Figaro, donne l’occasion au président de la République d’exprimer sa doctrine en matière de politique culturelle et de faire état de ses propres goûts. Dans cette interview, Jacques Chirac s’inscrit dans la continuité de la politique culturelle et patrimoniale telle qu’elle a été redéfinie par Jack Lang. Il insiste, en tout premier lieu (mais après avoir évoqué le rôle de l’École), sur le « patrimoine de proximité, telle grange, tel moulin, telle fontaine… qui fait la richesse d’un village, d’une région » et qu’il faut « rendre aux Français » , avant de s’engager dans un propos qui met en valeur sa connaissance des civilisations extra-européennes. Il se présente lui-même comme un amateur « éclectique » d’art et décrit, pour l’attester, les œuvres présentes dans son bureau lors de la rencontre avec le journaliste. C’est dans cette logique d’ouverture aux cultures du monde qu’il situe la création du musée des « Arts premiers » qui, elle-même, renoue avec la politique des « grands travaux » de son prédécesseur. "
Pour en savoir plus sur André Malraux, nous vous conseillons de lire des biographies à la bibliothèque ainsi que :
- André Malraux et le rayonnement culturel de la France / sous la direction de Jean-Yves Mollier
- André Malraux et le rayonnement culturel de la France / Charles-Louis Foulon
- Mon Combat pour la France / Jacques Chirac aux pages 95 et suivantes
Sur l'histoire du Panthéon :
- Naissance du Panthéon, Essai sur le culte des grands hommes / Jean-Claude Bonnet
- Les panthéonisations sous la Ve République : redécouverte et métamorphoses d'un rituel / Patrick Garcia
- Gouverner les mémoires, Les politiques mémorielles en France / Johann Michel
- Quelques articles du magazine L'histoire sur le Panthéon.
Enfin, nous vous présentons nos excuses pour le retard apporté à notre réponse et vous souhaitons une excellente année 2017.
Sur le site officiel du Panthéon, vous pourrez consulter un document qui retrace l'histoire des cérémonies d'hommage au Panthéon. En voici quelques extraits qui répondront à certaines de vos questions :
" Le culte des grands hommes est attesté déjà à l’époque de l’Antiquité dans l’œuvre de Plutarque et reprise pendant longtemps à l’époque de la royauté. Cependant, c’est au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, que la France montre un véritable engouement qui trouve son apothéose par la
Le culte des grands hommes pendant la Révolution resterait constamment partagé entre deux types divers d’exemplarité : le philosophe, grand homme solitaire et le militaire, héros collectif et patriote. Ce n’est plus le rang de naissance qui donne droit à la reconnaissance post mortem, mais l’œuvre et les actions réalisées pendant la vie. Contrairement au roi et aux nobles, le grand homme n'héritait pas son titre, celui-ci ne lui était pas donné par Dieu, il était acquis par la réussite personnelle à travers l'effort et le travail au service de l'humanité.
[...]
Le régime présidentiel de la Vème République donne une nouvelle vigueur à la tradition des funérailles républicaines du fait de la position prédominante du
politique.
Depuis cette date, le rythme des cérémonies qui se déroulent au Panthéon a largement dépassé celui de toutes les époques précédentes. Ce phénomène s'explique avec le nouveau regard qui est porté sur l'histoire à travers les commémorations. Elles visent à légitimer la politique en place. Le monument devient sous la Vème République le symbole d'un nouvel intérêt porté sur les rituels que l'on avait cru dépassés. Le président Mitterrand fait rentrer René Cassin (1987), Jean Monnet (1988), puis Monge, Condorcet et l'abbé Grégoire (1989) ainsi que Pierre et Marie Curie (1995). Jacques Chirac continue avec André Malraux (1996) et Alexandre Dumas (2002). Le Panthéon ne subit pas uniquement une simple réutilisation mais un véritable changement et la réinvention d'un rituel.
La première rupture avec l'ancien dispositif est significative et aura des conséquences sur les aspects scéniques de la cérémonie.
personne unique à qui reviennent l'initiative et la décision des transferts au Panthéon
source : La cérémonie d'hommage au Panthéon
Tout d'abord, Olivier LE NAIRE dans Entrez au Panthéon !: A la redécouverte de l'histoire de France explique que
" Jacques Chirac, lui, n’a jamais été un fervent admirateur du Panthéon. Cependant, il a pu constater l’
« Au début, Jacques Chirac, pas vraiment fan de Malraux, n’est pas très enthousiaste », se souvient Bernard Spitz, ancien conseiller de Michel Rocard et, pour sa part, inconditionnel de l’auteur de La Condition humaine. Mais lorsqu’il se rend compte que rien n’est prévu quelques mois seulement avant les vingt ans de la mort du romancier, le chef de l’Etat demande à son ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, de constituer un comité de commémoration, qui est confié à Spitz. La panthéonisation est donc préparée, mais
L'article de Garcia Patrick, « Jacques Chirac au Panthéon. Le transfert des cendres d'André Malraux (23 novembre 1996) » (Sociétés & Représentations, 2/2001 (n° 12), p. 205-222) nous en dit davantage sur les raisons qui ont motivé Jacques Chirac à faire entrer André Malraux au Panthéon :
" Cependant la panthéonisation d’André Malraux représente, pour le président, une
[Cette cérémonie fait] le pendant à la cérémonie d’intronisation de François Mitterrand. […] Mitterrand au Panthéon, c’était les retrouvailles de la gauche avec elle-même, le réenracinement dans une version de l’histoire de France [….]. La panthéonisation de Malraux, c’est aussi, pour Chirac, une forme de ressourcement, l’onction gaullienne
Ce ressourcement prend plusieurs formes. La plus visible est bien sûr, qu’
En outre, la personnalité et l’itinéraire de Malraux sont propices à démontrer que la généalogie de la droite ne saurait être réduite au conservatisme. Sous cet angle, André Malraux,
Enfin, après François Mitterrand qui posait volontiers en intellectuel, la célébration d’un homme de lettres, à la fois auteur, collectionneur et artisan d’une politique nationale de diffusion de la culture, donne l’occasion à Jacques Chirac d’apparaître, lui aussi, comme un
Il y a plus dans la résurrection de Malraux opérée par Chirac que son désir d’honorer un grand gaulliste. Dans un pays qui révère les intellectuels, le président, généralement présenté comme un homme qui aime plus la bière que les livres se sent vulnérable
L’entretien déjà cité, que Jacques Chirac accorde au Figaro, donne l’occasion au président de la République d’exprimer sa doctrine en matière de politique culturelle et de faire état de ses propres goûts. Dans cette interview, Jacques Chirac s’inscrit dans la continuité de la politique culturelle et patrimoniale telle qu’elle a été redéfinie par Jack Lang. Il insiste, en tout premier lieu (mais après avoir évoqué le rôle de l’École), sur le « patrimoine de proximité, telle grange, tel moulin, telle fontaine… qui fait la richesse d’un village, d’une région » et qu’il faut « rendre aux Français » , avant de s’engager dans un propos qui met en valeur sa connaissance des civilisations extra-européennes. Il se présente lui-même comme un amateur « éclectique » d’art et décrit, pour l’attester, les œuvres présentes dans son bureau lors de la rencontre avec le journaliste. C’est dans cette logique d’ouverture aux cultures du monde qu’il situe la création du musée des « Arts premiers » qui, elle-même, renoue avec la politique des « grands travaux » de son prédécesseur. "
Pour en savoir plus sur André Malraux, nous vous conseillons de lire des biographies à la bibliothèque ainsi que :
- André Malraux et le rayonnement culturel de la France / sous la direction de Jean-Yves Mollier
- André Malraux et le rayonnement culturel de la France / Charles-Louis Foulon
- Mon Combat pour la France / Jacques Chirac aux pages 95 et suivantes
Sur l'histoire du Panthéon :
- Naissance du Panthéon, Essai sur le culte des grands hommes / Jean-Claude Bonnet
- Les panthéonisations sous la Ve République : redécouverte et métamorphoses d'un rituel / Patrick Garcia
- Gouverner les mémoires, Les politiques mémorielles en France / Johann Michel
- Quelques articles du magazine L'histoire sur le Panthéon.
Enfin, nous vous présentons nos excuses pour le retard apporté à notre réponse et vous souhaitons une excellente année 2017.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




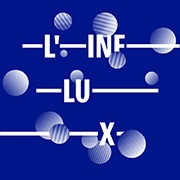 Harems et sultans : genre et despotisme au Maroc et...
Harems et sultans : genre et despotisme au Maroc et...