Question d'origine :
Bonjour,
Que pouvez-vous me dire à propos de la statue "le Grand Jeûneur" qui se trouvait sur le parvis de la cathédrale N.D. de Paris?
A quoi ressemblait-elle, quand a-t-elle été construite, quand a-t-elle finalement (et dans quelle circonstance) disparue?
Merci.
Dominique Dérubé
Réponse du Guichet
Le 03/02/2016 à 15h44
Votre question nous a doublement titillé l’esprit quand nous avons appris que la statue en question était mentionnée dans le roman populaire d’Anne Golon, Fêtes royales, Angélique, tome 3. Nous gardons tous en mémoire le personnage d’Angélique, interprétée au cinéma par Michèle Mercier, qui a ému profondément tant d’adolescents.
« … Bien que la place du Parvis fût close d'une murette, elle n’en conservait pas moins le désordre et le pittoresque qui en avaient fait jadis la place la plus populaire de Paris.
Les boulangers venaient toujours y vendre à bas prix, pour les indigents, leur pain de la semaine passée. Les badauds s'assemblaient toujours devant le Grand Jeûneur, cette énorme statue de plâtre, recouverte de plomb, et que les Parisiens, depuis des siècles, avaient toujours vue là. On ne savait pas ce que représentait ce monument : c'était un homme tenant d'une main un livre et de l'autre un bâton autour duquel s'entrelaçaient des serpents.
C'était le personnage le plus célèbre da Paris. On lui attribuait le pouvoir de parler les jours d'émeute pour exprimer les sentiments du peuple, et combien de libelles circulaient alors… »
Sur le site Naturales y místicas, on peut relever ce texte offrant une description de la statue, et qui précise également la date de sa disparition :
« Au milieu de l’espace limité, d’une part, par l’imposante basilique, et, de l’autre, par l’agglomération pittoresque des petits hôtels garnis de flèches, d’épis, de girouettes, percés de boutiques peintes aux poutrelles sculptées, aux enseignes burlesques, creusés sur leurs angles de niches ornées de madones ou de saints, flanqués de tourelles, d’échauguettes à poivrières, de bretèches, au milieu de cet espace, disons-nous, se dressait une statue de pierre, haute et étroite, qui tenait un livre d’une main et un serpent de l’autre. Cette statue faisait corps avec une fontaine monumentale où se lisait ce distique :
Qui sitis, huc tendas : desunt si forte liquores,
Pergredere, aeternas diva paravit aquas.
Toi qui as soif, viens ici: Si par hasard les ondes manquent,
Par degré, la Déesse a préparé les eaux éternelles.
Le peuple l’appelait tantôt Monsieur Legris, tantôt Vendeur de gris, Grand Jeûneur ou Jeûneur de Notre-Dame.
Bien des interprétations ont été données sur ces expressions étranges, appliquées par le vulgaire à une image que les archéologues ne purent identifier. La meilleure explication est celle que nous en fournit Amédée de Ponthieu1, et elle nous semble d’autant plus digne d’intérêt que l’auteur, qui n’était point hermétiste, juge sans parti pris et prononce sans idée préconçue :
«Devant ce temple, nous dit-il en parlant de Notre-Dame, se dressait un monolithe sacré que le temps avait rendu informe. Les anciens le nommaient Phœbigène, fils d’Apollon ; le peuple le nomma plus tard Maître Pierre, voulant dire Pierre maîtresse, pierre de pouvoir; il se nommait aussi messire Legris, alors que gris signifiait feu, et particulièrement feu grisou, feu follet...
»Selon les uns, ces traits informes rappelaient ceux d’Esculape, ou de Mercure, ou du dieu Terme; selon d’autres, ceux d’Archambaud, maire du Palais sous Clovis II, qui avait donné le fonds sus lequel l’Hôtel-Dieu était bâti; d’autres y voyaient les traits de Guillaume de Paris, qui l’avait érigé en même temps que le portail de Notre-Dame; l’abbé Lebœuf y voit la figure de Jésus-Christ; d’autres, celle de sainte Geneviève, patronne de Paris.» Cette pierre fut enlevée en 1748, quand on agrandit la place du Parvis-de-Notre-Dame. »
1 Amédée de Ponthieu, Légendes du Vieux Paris. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867, p. 91. »
Le portail Persée nous permet la lecture de deux articles de revues qui apportent sur la question l’éclairage scientifique d’historiens de l’art :
Erlande-Brandenburg Alain. Archéologie du Moyen Âge. In: École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1974-1975. 1975. pp. 677-681.
« La première question traitée fut celle du portail central de Notre-Dame de Paris. Le chargé de conférence avait déjà souligné dans un précédent article que le tympan avec le Christ, la Vierge et saint Jean, l'Ange porte-croix et celui qui porte les clous, n'était pas homogène, mais était le produit d'un assemblage tardif d'éléments qui n'appartenaient pas à la même date…
…Or il existait sur le parvis Notre-Dame une statue appelée populairement « le Jeuneur» ou « Monsieur le Gris », qui disparut en 1748, en qui l'abbé Lebeuf avait reconnu un Christ. Les dessins qui en sont conservés (Arch. nat. S1B et Cabinet des Estampes du musée Carnavalet, Topo 77-C) confirment singulièrement l'opinion du savant historien : on distingue en effet dans cette statue mutilée un Christ tenant le Livre d'une main et bénissant de l'autre.
Cette sculpture s'appuie en outre à un trumeau dont on aperçoit sur l'un des deux dessins la tranche moulurée. Malgré la médiocrité de ces documents iconographiques, on reconnait que le style de la sculpture est celui de la statue du musée Carnavalet, provenant d'un des piédroits de ce même portail. On a pu en conclure que le « Jeuneur » ou « Monsieur le Gris » était le trumeau initialement prévu pour le portail central, qui fut écarté au moment du montage de ce portail pour une raison qui nous échappe. »
Fleury Michel, Pronteau Jeanne. Histoire de Paris. In: École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1973-1974. 1974. pp. 525-566.
« Dès le milieu du XVIIe siècle une floraison d'échoppes envahirent le Parvis. Il y eut, en particulier, quatre échoppes adossées à la « ceinture » occidentale du Parvis, une au Sud de la fontaine et trois au Nord de cet ouvrage (3). L'échoppe méridionale tenait à la statue du Grand Jeûneur ; elle fut construite avant 1662 par
Charles Deguerre, marchand ouvrier à graver ; c'était une modeste baraque en planches, longue de 22 pieds, haute de 9 et large de 12 (7 m 12 sur 2 m 91 et 3 m 88), dont deux plans ont été conservés (le projet et la réalisation), lesquels ont pour principal mérite de donner la représentation du Jeûneur…
Les échoppes du parvis disparurent en 1748, au moment des vastes projets de Boffrand. Le 11 juin1749, leur démolition était consommée et le chapitre votait le règlement des dépenses engagées tant pour leur suppression que pour la démolition de Saint-Jean-Le-Rond et autres opérations (5).
L'histoire de la statue du grand Jeûneur a été écrite (6). On n'a rappelé que pour mémoire l'existence de cette statue de pierre, citée pour la première fois par Raoul Boutray en 1611 (7), qui se dressait à l'extrémité de la « ceinture » du Parvis, face à la porte de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. On a vu en elle, au XVIIe siècle, Esculape (1), maie aussi la représentation de Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris au XVIIIe siècle, de Mercure ou d'un dieu Therme (2) un. Moreau de Mautour (3), en 1723, y voyait un ancien maire du palais, Archambauld, et donnait pour la première fois une notion de grandeur : 12 pieds de hauteur, plus de 2 pieds de diamètre (3 m 88 sur 0 m 65). Mais c'est l'opinion de Lebeuf qu'il convient de retenir - Lebeuf qui fût le dernier témoin oculaire et qui examina de près le monument au moment de sa démolition (4) : frappé de la ressemblance existant entre le Jeûneur et l'ancienne statue du Christ qui ornait le portail central de Notre-Dame, Lebeuf vit, dans la masse de pierre sculptée qui s'élevait sur le Parvis, la représentation du Christ et considéra le Jeûneur comme provenant d'une ancienne église du Parvis (Saint-Étienne, la première Notre-Dame ou Saint-Christophe).
Le Jeûneur, qui s'élevait à environ 15 toises (29 m 23) de la cathédrale (5), disparut en 1748 (6) lors de l'aménagement du Parvis.
Une question restait posée : le Jeûneur eut-il une destination quelconque ? On a voulu voir en lui une borne, et plus spécialement la borne initiale des mesures itinéraires de France (1).
Ce point de vue semble erroné. Des recherches jusqu'ici conduites il ressort : 1° qu'il existait dans le sol du Parvis, depuis un temps indéterminé, un poteau portant les armes du chapitre, visible sur un dessin de 1699 (2), lequel n'avait pas de destination précise ; 2° que le chapitre décida, en 1762, de faire remplacer le vieux poteau par un poteau neuf (3), lequel n'était pas encore planté en 1767, bien qu'il y ait eu un plan et un procès-verbal de bornage du Parvis levés à cet effet (4) ; le poteau fut fiché en avril 1768, au pied de la tour septentrionale de la cathédrale ; il eut un objet précis : servir de point de départ aux bornes qui, de mille en mille toises, commençaient à diviser les routes du royaume (5). Bien que le texte qui ait établi le mesurage des routes de France, n'ait pas été retrouvé, on peut le dater de 1767-1768 (6).
C'est à cette dernière date que le poteau aux armes du chapitre servit de point de départ au mesurage des routes du royaume (7).
Statue du Christ descendue d'une ancienne église du Parvis, le Jeûneur n'était donc qu'un témoignage du passé, dont Jaillot déplora la disparition (8).
3) Voir Fay et Jarry, Le Grand Jeûneur et les échoppes du parvis Notre-Dame, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris..., 1930, p. 33-40.
(6) Par L'Esprit, « Le Jeûneur de Notre-Dame », 1912, 80 p. (extr. De La Cité, octobre 1911-janvier 1912).
(7) Rodolphi Boterii... Lutetia, 1611, p. 13-14.
(4) Lebeuf, éd. Cocheris, t. I, p. 10, et Sur une ancienne statue récemment ôtée du Parvis..., dans Histoire de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXI, 1754, p. 182-185 (compte rendu d'une commucation faite à l'Académie dans la séance du 24 mai 1748).
(1) L'Esprit, Jeûneur de Notre-Dame, p. 33-40, 68.
(8) Jaillot, Recherches... Premier quartier, La Cité, p. 115. Cet auteur affirme, à tort, que la statue était « de plâtre couvert de plomb » ; elle était en réalité de pierre.
Sur le site Paris au Moyen Âge : bibliographie et chronologie, on trouve les deux références d’articles de périodiques sur lesquelles se fondent les recherches ultérieures :
L’ESPRIT (Adolphe). « Le Jeûneur de Notre-Dame », La Cité. Société historique et archéologique du IVe arrondissement de Paris, oct. 1911, p. 313-352 et janv. 1912, p. 5-45. -
> Extr. : Paris, H. Champion, 1912. In-8°, 80 p., fig..
Vous avez la possibilité de savoir quelles bibliothèques possèdent ce document en cliquant sur le lien
En outre, vous disposez d’une version numérique à lire gratuitement sur le site Gallica.
Autre parution : La Cité. Société historique et archéologique des IVe et IIIe arrondissements de Paris, 30e année, 1931, p. 356-373, ill.
FAY (Dr H.-Marcel) et JARRY (Paul). « Le Grand Jeûneur et les échoppes du parvis Notre-Dame », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 57e année, 1930, p. 29-46, plans, ill.
Etat de collection : 1874 - 1895 ; 1897 - 1926 ; 1928 -....
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Existe-t-il un projet de piscine olympique sur l'agglomération...
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




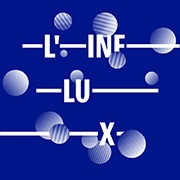 Pétrole et gaz
Pétrole et gaz