Question d'origine :
Il y a quelques années un femme laide était comparée à un boudin,pourquoi?quel rapport avec le boudin?
Maintenant une femme laide est comparée à un thon,pourquoi?quel rapport avec le thon ?
Et pourquoi cette évolution dans le vocabulaire?
merci
Réponse du Guichet
Le 04/06/2012 à 13h49
Bonjour,
Poubelle, cageot, boudin, gros tas, thon, tels sont les doux mots utilisés pour désigner la créature de ses rêves. Et que dire encore lorsque l’on vous interpelle par un « elle est fraîche, elle est fraîche la morue ».
Mais trêves de bavardage, pour répondre à vos interrogations et comprendre l’évolution des termes employés, il importe de revenir sur le sens même de l’argot. En effet, comme l’explique l’article publié sur Wikipedia l'utilisation de l'argot est une façon de contourner les tabous instaurés par la société.
Il n'existe pas un argot, mais des argots (ou des parlures argotiques, pour reprendre l'expression de Denise François-Geiger et Jean-Pierre Goudaillier). Différents groupes sociaux ont développé, à des époques différentes, leur propre parler. L'importance des fonctions cryptique et identitaire varie entre les argots. On remarque que la tendance actuelle privilégie l'identitaire sur le cryptique : le français contemporain des cités en particulier a moins besoin de masquer son message que de marquer l'appartenance à son groupe et, par opposition, son rejet de la société préétablie.
Pour que les tiers soient maintenus dans l'incompréhension de la communication, l'argot doit constamment renouveler ses procédés d'expression, spécifiquement son lexique (…)
En fait, l'argot est toujours connu pour son vocabulaire, mais cela ne signifie pas qu'il suit les règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques, pragmatiques... de la langue standard. La formation des phrases, la prononciation, l'intonation, la gestuelle... sont très différentes de la norme officielle et participent donc à la distinction du groupe. Néanmoins, les procédés autres que lexicaux utilisés par l'argot ne lui sont en général pas propres : il s'agit généralement de caractères du langage familier ou populaire.
Quant aux procédés d'élaboration lexicale, ils sont de deux types : soit sémantiques (modification et jeu sur les sens des mots), soit formels (création ou modification de mots). Lorsque l'élaboration lexicale est formelle, on assiste souvent à une déconstruction du langage courant : l'argot déforme, mélange, déstructure, découpe... les mots et enfreint les règles. Cette déconstruction laisse transparaître la volonté du groupe social de se démarquer en rejetant la société établie.
D’ailleurs, dans l’étude La dynamique du français des jeunes : sept ans de mouvement à travers deux enquêtes (1987-1994), M. Sourdot effectue des comparaisons permettant d’étudier l’évolution de l’argot.
Mais revenons à nos boudins.
Si nous ne savons d’où vient l’utilisation en argot de boudin, il apparaît que ce terme a pu être employé comme une insulte dès le XVIIe siècle mais avec une signification un peu différente. Par exemple faire un boudin, c’est à dire marier un gentilhomme à une riche roturière reposait sur une plaisanterie : le boudin étant fait de sang (la noblesse) et de graisse (l’argent, symbolisé par la bourgeoisie).
Source : Albert Doillon, Dictionnaire de l'argot [Livre] : l'argent, la santé, le sexe, le sport, la violence.
Dans dictionnaire des mots qu’on dit gros, de l'insulte et du dénigrement, Robert Gordienne propose une autre origine : De bod, exprimant l’enflure, la bedaine. Sert à désigner exclusivement une « fille mal faite, petite et grosse, sans aucune grâce et mal fagotée ». le boudin répugne.
De même, Jean-Paul Colin, Jean-Pierre Mével, Christian Leclerc dans Dictionnaire de l'argot français et de ses origines relèvent que le mot de boudin peut être employé, toujours de manière péjorative, pour désigner une vieille prostituée [le boudin correspondant au rouleau de pièces de monnaie ; le gain d’une prostituée (1899)]
Ainsi les auteurs notent l’évolution de l’emploi de ce terme : de l’analogie de forme « objet cylindrique » auquel vient ‘ajouter le sens de gain et d’une analogie de forme et de consistance plus ou moins obscène jusqu’à l’idée de « gonzesse ».
Quoi qu’il en soit, ce terme évoque dès l’origine l’idée de gras par analogie de forme et de consistance plus ou moins obscène, et est alors employé pour désigner une femme grosse, peu soignée et franchement laide.
Quant au « thon », le terme employé de manière péjorative apparaîtrait d’après le Dictionnaire culturel en langue française vers 1998 mais Albert Doillon le recense dès 1992 dans La Grosse Bertha.
Le site ac-grenovble.fr explique que depuis peu, ce mot ne désigne pas exclusivement le poisson des mers, mais aussi, de manière imagée, des personnes que l’utilisateur en question de ce mot va juger déplaisante physiquement à son goût. C’est une métaphore.
Exemples : « Cette fille est un vrai thon ! » « Si elle continue de changer comme ça, elle va se transformer en thon ! »
De nos jours, être un thon signifie être laid, ou laide. C’est une manière imagée de critiquer les personnes sur leur physique, en les comparants à un poisson des mers, qui, à première vue, n’est pas vraiment attirant.
Ce mot est péjoratif à l’encontre d’une personne et est considéré comme une insulte moyenne, il ne change pas de forme au féminin.
Des adjectifs comme « gros », ou, encore, de manière ironique « beau » sont parfois associés au mot pour une signification d’avantage péjorative.
Pour compléter cette première approche et comprendre l’histoire de l’argot, nous vous conseillons ces quelques lectures :
Métro, boulot, machos : Enquête sur les insultes sexistes au travail / Katie Breen, Catherine Durand; préf. Isabelle Alonso, 2002.
Ernotte Philippe, Rosier Laurence L'ontotype : une sous-catégorie pertinente pour classer les insultes ?, Langue française. N°144, 2004. Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques. pp. 35-48.
Fisher Sophie, L'insulte : la parole et le geste, Langue française. N°144, 2004. Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques. pp. 49-58.
Poubelle, cageot, boudin, gros tas, thon, tels sont les doux mots utilisés pour désigner la créature de ses rêves. Et que dire encore lorsque l’on vous interpelle par un « elle est fraîche, elle est fraîche la morue ».
Mais trêves de bavardage, pour répondre à vos interrogations et comprendre l’évolution des termes employés, il importe de revenir sur le sens même de l’argot. En effet, comme l’explique l’article publié sur Wikipedia l'utilisation de l'argot est une façon de contourner les tabous instaurés par la société.
Il n'existe pas un argot, mais des argots (ou des parlures argotiques, pour reprendre l'expression de Denise François-Geiger et Jean-Pierre Goudaillier). Différents groupes sociaux ont développé, à des époques différentes, leur propre parler. L'importance des fonctions cryptique et identitaire varie entre les argots. On remarque que la tendance actuelle privilégie l'identitaire sur le cryptique : le français contemporain des cités en particulier a moins besoin de masquer son message que de marquer l'appartenance à son groupe et, par opposition, son rejet de la société préétablie.
Pour que les tiers soient maintenus dans l'incompréhension de la communication, l'argot doit constamment renouveler ses procédés d'expression, spécifiquement son lexique (…)
En fait, l'argot est toujours connu pour son vocabulaire, mais cela ne signifie pas qu'il suit les règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques, pragmatiques... de la langue standard. La formation des phrases, la prononciation, l'intonation, la gestuelle... sont très différentes de la norme officielle et participent donc à la distinction du groupe. Néanmoins, les procédés autres que lexicaux utilisés par l'argot ne lui sont en général pas propres : il s'agit généralement de caractères du langage familier ou populaire.
Quant aux procédés d'élaboration lexicale, ils sont de deux types : soit sémantiques (modification et jeu sur les sens des mots), soit formels (création ou modification de mots). Lorsque l'élaboration lexicale est formelle, on assiste souvent à une déconstruction du langage courant : l'argot déforme, mélange, déstructure, découpe... les mots et enfreint les règles. Cette déconstruction laisse transparaître la volonté du groupe social de se démarquer en rejetant la société établie.
D’ailleurs, dans l’étude La dynamique du français des jeunes : sept ans de mouvement à travers deux enquêtes (1987-1994), M. Sourdot effectue des comparaisons permettant d’étudier l’évolution de l’argot.
Mais revenons à nos boudins.
Si nous ne savons d’où vient l’utilisation en argot de boudin, il apparaît que ce terme a pu être employé comme une insulte dès le XVIIe siècle mais avec une signification un peu différente. Par exemple faire un boudin, c’est à dire marier un gentilhomme à une riche roturière reposait sur une plaisanterie : le boudin étant fait de sang (la noblesse) et de graisse (l’argent, symbolisé par la bourgeoisie).
Source : Albert Doillon, Dictionnaire de l'argot [Livre] : l'argent, la santé, le sexe, le sport, la violence.
Dans dictionnaire des mots qu’on dit gros, de l'insulte et du dénigrement, Robert Gordienne propose une autre origine : De bod, exprimant l’enflure, la bedaine. Sert à désigner exclusivement une « fille mal faite, petite et grosse, sans aucune grâce et mal fagotée ». le boudin répugne.
De même, Jean-Paul Colin, Jean-Pierre Mével, Christian Leclerc dans Dictionnaire de l'argot français et de ses origines relèvent que le mot de boudin peut être employé, toujours de manière péjorative, pour désigner une vieille prostituée [le boudin correspondant au rouleau de pièces de monnaie ; le gain d’une prostituée (1899)]
Ainsi les auteurs notent l’évolution de l’emploi de ce terme : de l’analogie de forme « objet cylindrique » auquel vient ‘ajouter le sens de gain et d’une analogie de forme et de consistance plus ou moins obscène jusqu’à l’idée de « gonzesse ».
Quoi qu’il en soit, ce terme évoque dès l’origine l’idée de gras par analogie de forme et de consistance plus ou moins obscène, et est alors employé pour désigner une femme grosse, peu soignée et franchement laide.
Quant au « thon », le terme employé de manière péjorative apparaîtrait d’après le Dictionnaire culturel en langue française vers 1998 mais Albert Doillon le recense dès 1992 dans La Grosse Bertha.
Le site ac-grenovble.fr explique que depuis peu, ce mot ne désigne pas exclusivement le poisson des mers, mais aussi, de manière imagée, des personnes que l’utilisateur en question de ce mot va juger déplaisante physiquement à son goût. C’est une métaphore.
Exemples : « Cette fille est un vrai thon ! » « Si elle continue de changer comme ça, elle va se transformer en thon ! »
De nos jours, être un thon signifie être laid, ou laide. C’est une manière imagée de critiquer les personnes sur leur physique, en les comparants à un poisson des mers, qui, à première vue, n’est pas vraiment attirant.
Ce mot est péjoratif à l’encontre d’une personne et est considéré comme une insulte moyenne, il ne change pas de forme au féminin.
Des adjectifs comme « gros », ou, encore, de manière ironique « beau » sont parfois associés au mot pour une signification d’avantage péjorative.
Pour compléter cette première approche et comprendre l’histoire de l’argot, nous vous conseillons ces quelques lectures :
Métro, boulot, machos : Enquête sur les insultes sexistes au travail / Katie Breen, Catherine Durand; préf. Isabelle Alonso, 2002.
Ernotte Philippe, Rosier Laurence L'ontotype : une sous-catégorie pertinente pour classer les insultes ?, Langue française. N°144, 2004. Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques. pp. 35-48.
Fisher Sophie, L'insulte : la parole et le geste, Langue française. N°144, 2004. Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques. pp. 49-58.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




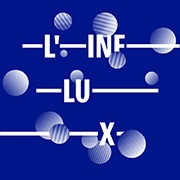 L’ajustement fin : le plus grand mystère de l’univers
L’ajustement fin : le plus grand mystère de l’univers