Réponse du département Langues et LittératuresD'après toutes les recherches que nous avons faites dans les dictionnaires étymologiques nous n'avons pas trouvé de racines communes aux trois mots que vous citez:
c'est le mot rêve ou le verbe rêver qui a l'étymologie la moins certaine et la seule qui ne soit pas latine :
voici ce qu'en dit le :
TLFI :
Trésor de la Langue Française informatisé :
Rêver :
Étymol. et Hist.
1. Ca 1130 resver « délirer à cause d'une maladie » (Lapidaires anglo-normands, éd. P. Studer et J. Evans, V, 1312, p. 246); ca 1240 reever « radoter » (MATTHIEU PARIS, L'Histoire de Saint Edouard Le Roi, éd. K. Y. Wallace, 3786); 1538 faire resver « induire en erreur » (EST., s.v. incutere); 1552 resver « être perdu, absorbé dans des pensées vagues » (RONSARD, Les Amours, CXII ds Œuvres, éd. P. Laumonier, t. 4, p. 110: J'iray toujours et resvant et songeant); déb. XVIIe s. resver à « penser à » (D'AUBIGNÉ, Confession du sieur de Sancy ds Œuvres, éd. E. Réaume et De Caussade, t. 2, p. 368); ca 1620 resver « réfléchir » (ID., Lettres de poincts de science, t. 1, p. 436); déb. XVIIe s. resver « imaginer, voir comme dans un rêve » (ID., Confession du sieur de Sancy, t. 2, p. 293); 1606 resver « désirer quelque chose ardemment » (RÉGNIER, Satyre IX, 181 ds Œuvres, éd. G. Raibaud, p. 103); 1640 « voir en rêve » (CORNEILLE, Polyeucte, I, 1); 1649 « faire des rêves en dormant » (DESCARTES, Traité des Passions ds Rom. Forsch. t. 86, p. 490); 2. 1269-78 resver « vagabonder, errer pour son plaisir, faire une promenade » (JEAN DE MEUN, Rose, éd. F. Lecoy); en partic. 1491 raver « se promener déguisé pendant le carnaval » (J. AUBRION, Journ. ds GDF.). Mot d'orig. incertaine, peut-être dér. d'un verbe non att. *esver « vagabonder » (d'où aussi desver « perdre le sens », v. endêver; v. aussi GUIR. Lex. fr. Étymol. obsc. qui propose de rattacher le mot à *reexvadare, dér. du lat. evadere « sortir, s'échapper de »). Vers la fin du XVIIe s., rêver tend à supplanter songer au sens de « faire des rêves en dormant » (d'où aussi l'apparition de rêve avec le développement sém. qu'a pris le verbe à cette époque). et ce que dit :
Le Littré :
Rêver:
Origine incertaine. Parmi les langues romanes, jusqu'à présent on ne connaît rêver que dans le français. Le P. Labbe, Ampère et Génin ont supposé une parenté entre rêver et desver (voy. ENDÊVER). On a indiqué l'anglais to rave, avoir le délire ; mais le mot anglais paraît venir du français, non le français de l'anglais ; il en est de même du flamand reven, revelen, et du moyen haut-allemand reben. Diez conjecture que rêve est une forme dialectique pour rage, et représente le latin rabies. Cette conjecture ne satisfait ni à la forme (rabies ayant déjà donné rage), ni au sens (rever signifiant essentiellement vagabonder, faire le vaurien). On satisfait mieux à l'une et à l'autre en s'adressant au danois roeuve, angl. to rove, errer, vagabonder, faire le bandit, d'où, en anglais, avoir le délire, et, en français, faire un rêveen ce qui concerne le mot
rébellion tous les dictionnaires consultés indiquent la même origine : du latin rebellio (v.1212) = reprise des hostilités
La racine duell (bell), (bellum = guerre) exprime l'idée de bataille in :
Trésors des racines latines , de Jean Bouffartigue et Anne-Marie Delrieu
Quant au mot
révéler voici ce qu'on trouve dans :
Curiosités étymologiques , de René Garrus :
"
Révélation : du latin velum = rideau. Velum désignait plus particulièrement l'étoffe tendue au-dessus des tribunes, au cours des spectacles en plein air. Le français emprunta le mot latin dans cette dernière acception: dans notre langue, le vélum est un toit de toile. Par transmission populaire, velum donna le nom masculin voil, bientôt écrit voile.
Le verbe dérivé velare = couvrir d'un voile, = cacher, avait un contraire revelare = dévoiler, découvrir. Ce dernier s'employait surtout au sens figuré, ainsi que le nom dérivé revelatio = action de dévoiler. Le français emprunta les deux mots révéler et révélation"
Si vous êtes passionnés par les mots et leurs origines nous vous conseillons la consultation du site :
Lexilogos où vous trouverez tous les dictionnaires que nous avons cités, ainsi qu'un lexique des racines indo-européennes.



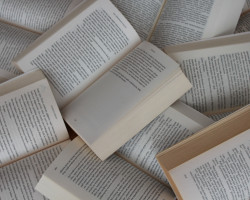
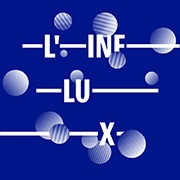 Reines : l’art du drag à la française
Reines : l’art du drag à la française