Question d'origine :
Les réseaux sociaux rendent-ils vraiment addicts ?
Réponse du Guichet
Le 25/11/2019 à 15h38
Bonjour,
L'application du terme d'"addiction" pour les réseaux sociaux ne fait pas aujourd'hui consensus dans le monde scientifique, comme nous vous l'avions dit dans une précédente réponse faisant référence à un article de l’ Observatoire sociétal de la Fédération Française des Télécoms :
« La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd'hui dans toutes les bouches : dans une enquête récente, nos interviewés se disent volontiers « addict » (à leur téléphone mobile, à facebook, à Twitter, aux séries télé…), de nombreux articles de presse fleurissent sur le sujet, des robinsonnades qui vantent les mérites de quelques mois « sans » ( internet, mobile, …) paraissent dans plusieurs pays (dont « J’ai débranché, Comment revivre sans Internet après une overdose », de Thierry Crouzet), et des études quantitatives mesurent désormais combien de français se déclarent « dépendants ».
Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l'invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l'égard de certains outils et services numériques est un abus de langage.
En effet, la définition médicale de « l'addiction sans drogue », dite aussi « addiction comportementale » suppose a minima une reconnaissance par le sujet des dommages physiques et psychiques causés par son usage excessif et l'incapacité de réduire ou de réajuster sa conduite. Or, ce que nous racontent nos interviewés, peu après s’être présentés comme « addicts », ce sont précisément les incessants ajustements de leurs pratiques, au service d’une auto-discipline désormais perçue comme nécessaire. »
Pourtant, il est peu douteux que l’usage d’internet et des réseaux sociaux provoquent des comportements abusifs, mais surtout, sont vecteurs d’addictions annexes, selon Accro ! [Livre] / Laurent Karila, Annabel Benhaim :
« L’addiction au Webb a de nombreux synonymes : cyberdépendance, cyberaddiction, cyberaholism, addiction au Net, Internetaholism, usage problématique d’Internet. Cette pathologie n’existe pas dans les grandes classifications internationales des maladies. Cependant, par analogie avec les troubles liés à l’usage des substances ou avec les jeux de hasard et d’argent, les similitudes cliniques et comportementales sont frappantes. »
Et de citer un chercheur américain, Golberg, qui a adapté dès 1995 « les critères de dépendance à une substance […] au support qu’est Internet », et a observé – avant même que les réseaux sociaux connaissent leur développement actuel ! – des problèmes semblables tels que le phénomène de tolérance accrue (le sujet a besoin d’augmenter constamment la dose pour atteindre le même degré de satisfaction), le manque, les répercussions sur la vie de famille, la désociabilisation… Concernant les réseaux sociaux en tant que tels, les auteurs poursuivent :
« Des chercheurs norvégiens en psychologie ont récemment développé un questionnaire évaluant l’addiction à Facebook […]. L’addiction à Facebook est une forme clinique de la dépendance à Internet puisqu’il rassemble un comportement répétitif, une perte de contrôle et la poursuite de ce comportement, malgré la connaissance des conséquences négatives. »
C’est également ce qu’observe le journaliste Jérôme Colombain dans son ouvrage Faut-il quitter les réseaux sociaux ? [Livre] : les 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube :
« Qu’il s’agisse ou pas d’une addiction au sens médical du terme, la techno-dépendance n’est, en tout cas, pas sans conséquence. Anxiété, trous de mémoire, perte de confiance en soi… Non contents de nous manipuler, les réseaux sociaux pratiqués à haute dose auraient carrément des effets nocifs sur notre santé mentale et physique. Le phénomène serait surtout sensible chez les plus jeunes, qui sont évidemment les plus vulnérables.
Troubles du sommeil, stress, perte de concentration
La pratique abusive des réseaux sociaux est mauvaise pour la santé. D’abord, pour le sommeil. La fameuse lumière bleue, générée par les écrans, serait un excitant néfaste au moment où l’on a plutôt besoin de calme pour un bon endormissement. Ensuite, le contenu même des réseaux agite le cerveau. Les sollicitations, les échanges qui n’en finissent pas, les conversations prenantes peuvent provoquer du stress à un moment où on en a le moins besoin. […]
La pratique des réseaux sociaux peut également engendrer de l’anxiété et du stress dans la journée. L’impossibilité de consulter son fil Twitter ou Facebook parce qu’on est en réunion ou au volant peut déclencher une bonne crise de fomo [i.e. : peur d’être coupé de son portable]. Ce qu’on lit sur les réseaux peut également provoquer de la contrariété […].
Paradoxalement, les réseaux sociaux favoriseraient le sentiment d’isolement et de solitude. C’est ce qui ressort d’une étude américaine menée en 2014 [Brian A. Primack, Social media use and percieving social isolation among young adults in the US, University of Pittsburgh, 2014]. Les personnes pratiquant le Web 2.0 plus de deux heures pa jour se sentiraient deux fois plus isolées que celles qui n’y consacrent pas plus d’une demi-heure au quotidian.
[…]
Selon une étude britannique de la Société royale de santé publique, Instagram, avec ses milliers de photos retouchées prônant la perfection physique, serait le réseau social qui nuit le plus aux jeunes. D’après cette étude, sept jeunes sur dix reconnaissent qu’Instagram les fait se sentir mal dans leur peau, suscite un sentiment d’envie, d’infériorité, et donne l’impression de rater sa vie.
[…]
Selon une grande étude réalisée par des psychologues des universités de San Diego et de Floride, les adolescents branchés sur leurs smartphones plus de cinq heures par jour ont 66% de risque supplémentaire de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu’une heure quotidienne aux écrans. »
Les auteurs de l'étude définissent l'addiction au smartphone ainsi : une envie constante de se servir de l'objet, pouvant se traduire par une sensation de mal-être en cas de privation. « Il y a un problème quand les gens dépendent tellement de l'appareil qu'ils peuvent se sentir anxieux s'ils n'y ont pas accès et qu'ils l'utilisent au détriment de leur vie quotidienne », estime Matthew Lapierre, professeur assistant au département de communication de l'université d'Arizona et auteur principal de l'étude.
Le Pr Lapierre et son équipe ont interrogé 346 adolescents en deux temps, sur une période totale de 3 mois. Publiée dans le Journal of Adolescent Health, l'étude a sélectionné des participants âgés de 17 à 20 ans. Les chercheurs ont proposé aux volontaires d'évaluer leur sentiment de manque sur une échelle de 1 à 4, en répondant à une série d'énoncés, tels que « Je panique lorsque je ne peux pas utiliser mon smartphone ». Les participants ont également répondu à des questions conçues pour jauger leur sentiment de solitude, leurs symptômes dépressifs et la fréquence d'utilisation de leur téléphone.
En analysant les réponses des volontaires, les chercheurs ont constaté qu'une forte dépendance au smartphone était liée à des risques accrus de développer des symptômes dépressifs et de solitude. Leurs recherches confirment donc ce qui a été démontré dans plusieurs études antérieures : à savoir qu'un usage intensif du smartphone a tendance à isoler et à favoriser l'anxiété.
À la lumière de ces résultats, les auteurs de l'étude estiment qu'il pourrait être utile pour les personnes concernées d'évaluer leur relation avec leurs appareils et de s'imposer des limites si nécessaire. « Si quelqu'un recourt à son smartphone comme rempart contre le stress, il peut par exemple tenter d'autres approches plus saines, comme parler à un ami proche pour obtenir du soutien ou faire des exercices de méditation », suggère le chercheur Pengfei Zhao, co-auteur de l'étude."
(Source : futura-sciences.com)
Nous n’avons certes pas la compétence suffisante pour trancher le débat de savoir si le terme « addiction », dans son acception médicale, est correcte lorsqu’il s’agit d’Internet ; cependant, tous les documents que nous avons pu consulter montre que le medium, et en particulier les réseaux sociaux, poussent les personnes fragiles à des comportements délirants – que penser alors des anciens cadres repentis des GAFAM, évoqués par Sciences et avenir, qui se mettent à alerter à leur tour l’opinion des dangers des réseaux qui les ont enrichis ?
« Quelle est la première chose que vous faites le matin après vous être réveillé ? En 2016, pour un Français sur 5, il s'agissait déjà de regarder son téléphone portable. En moyenne, nous regardons nos smartphones plus de 26 fois par jour, selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte. Outre-Atlantique, des anciens de Facebook ou de Google s'inquiètent de ce système qu'ils ont participé à concevoir. Ils décrient notamment l'addiction provoquée de façon délibérée par ces réseaux sociaux pour que les internautes passent toujours plus de temps en ligne, ce qu'on appelle économie de l'attention. Ces repentis ont créé le Centre pour une technologie humaine (Center for Humane Technology), qui va financer à hauteur de 7 millions de dollars une campagne médiatique aux États-Unis. L'objectif : informer les enfants et leurs parents des dangers découlant de l'usage des technologies, et notamment des réseaux sociaux.
"Facebook détruit le tissu social"
Ces anciens de la Tech qui désormais la critiquent, qui sont-ils ? L'initiative est largement fédérée par Tristan Harris, son co-fondateur, ancien éthicien chez Google. Celui-ci s'était fait connaître en 2014, en critiquant l'économie de la distraction promue par les réseaux (voir sa vidéo à TEDxBrusels). "Nous étions à l'intérieur, nous savons bien ce que mesurent les géants de la Tech et où se place l'ingénierie", a indiqué Tristan Harris dans les colonnes du New York Times (en anglais). En décembre 2017, un ancien dirigeant de Facebook, Chamath Palihapitiya, estimait pour sa part que le réseau social "détruisait le tissu social de la société" (lien en anglais). Et ce n'est pas tout : on compte aussi parmi les membres fondateurs Justin Rosenstein, l'inventaire du fameux bouton "J'aime" de Facebook.
ENFANTS. L'impact social est au cœur de l'initiative. "La course pour l'attention est en train de détruire les piliers de notre société : notre santé mentale, nos enfants, nos relations sociales et même la démocratie", peut-on lire sur son site. "Ce qui est bon pour retenir notre attention n'est pas bon pour notre bien-être : Snapchat redéfinit la façon dont nos enfants mesurent l'amitié." La campagne médiatique va ainsi cibler 55.000 écoles publiques aux États-Unis. Car l'inquiétude gagne : "Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau des enfants", s'était alarmé Sean Parker, l'un des premiers investisseurs à miser sur le réseau social (lien en anglais).
La santé des GAFA au beau fixe
Roger McName, ancien conseiller de Mark Zuckerberg lors des débuts de Facebook, a dit au New York Times qu'il était horrifié. "Facebook cible votre cerveau reptilien, celui qui réagit à la peur et à la colère. Et avec les smartphones, Facebook peut bénéficier de votre attention à chaque instant", a-t-il indiqué. Mais il n'empêche que la santé d'Amazon, de Google ou de Facebook n'a jamais été aussi bonne (lien en anglais) : le chiffre d'affaires d'Apple a grimpé de 13%, il est également en hausse chez Facebook. Pas dit que dans ces conditions, les géants de la Tech soient vraiment prêts à tendre l'oreille... »
Bonne journée.
L'application du terme d'"addiction" pour les réseaux sociaux ne fait pas aujourd'hui consensus dans le monde scientifique, comme nous vous l'avions dit dans une précédente réponse faisant référence à un article de l’ Observatoire sociétal de la Fédération Française des Télécoms :
« La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd'hui dans toutes les bouches : dans une enquête récente, nos interviewés se disent volontiers « addict » (à leur téléphone mobile, à facebook, à Twitter, aux séries télé…), de nombreux articles de presse fleurissent sur le sujet, des robinsonnades qui vantent les mérites de quelques mois « sans » ( internet, mobile, …) paraissent dans plusieurs pays (dont « J’ai débranché, Comment revivre sans Internet après une overdose », de Thierry Crouzet), et des études quantitatives mesurent désormais combien de français se déclarent « dépendants ».
Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l'invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l'égard de certains outils et services numériques est un abus de langage.
En effet, la définition médicale de « l'addiction sans drogue », dite aussi « addiction comportementale » suppose a minima une reconnaissance par le sujet des dommages physiques et psychiques causés par son usage excessif et l'incapacité de réduire ou de réajuster sa conduite. Or, ce que nous racontent nos interviewés, peu après s’être présentés comme « addicts », ce sont précisément les incessants ajustements de leurs pratiques, au service d’une auto-discipline désormais perçue comme nécessaire. »
Pourtant, il est peu douteux que l’usage d’internet et des réseaux sociaux provoquent des comportements abusifs, mais surtout, sont vecteurs d’addictions annexes, selon Accro ! [Livre] / Laurent Karila, Annabel Benhaim :
« L’addiction au Webb a de nombreux synonymes : cyberdépendance, cyberaddiction, cyberaholism, addiction au Net, Internetaholism, usage problématique d’Internet. Cette pathologie n’existe pas dans les grandes classifications internationales des maladies. Cependant, par analogie avec les troubles liés à l’usage des substances ou avec les jeux de hasard et d’argent, les similitudes cliniques et comportementales sont frappantes. »
Et de citer un chercheur américain, Golberg, qui a adapté dès 1995 « les critères de dépendance à une substance […] au support qu’est Internet », et a observé – avant même que les réseaux sociaux connaissent leur développement actuel ! – des problèmes semblables tels que le phénomène de tolérance accrue (le sujet a besoin d’augmenter constamment la dose pour atteindre le même degré de satisfaction), le manque, les répercussions sur la vie de famille, la désociabilisation… Concernant les réseaux sociaux en tant que tels, les auteurs poursuivent :
« Des chercheurs norvégiens en psychologie ont récemment développé un questionnaire évaluant l’addiction à Facebook […]. L’addiction à Facebook est une forme clinique de la dépendance à Internet puisqu’il rassemble un comportement répétitif, une perte de contrôle et la poursuite de ce comportement, malgré la connaissance des conséquences négatives. »
C’est également ce qu’observe le journaliste Jérôme Colombain dans son ouvrage Faut-il quitter les réseaux sociaux ? [Livre] : les 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube :
« Qu’il s’agisse ou pas d’une addiction au sens médical du terme, la techno-dépendance n’est, en tout cas, pas sans conséquence. Anxiété, trous de mémoire, perte de confiance en soi… Non contents de nous manipuler, les réseaux sociaux pratiqués à haute dose auraient carrément des effets nocifs sur notre santé mentale et physique. Le phénomène serait surtout sensible chez les plus jeunes, qui sont évidemment les plus vulnérables.
Troubles du sommeil, stress, perte de concentration
La pratique abusive des réseaux sociaux est mauvaise pour la santé. D’abord, pour le sommeil. La fameuse lumière bleue, générée par les écrans, serait un excitant néfaste au moment où l’on a plutôt besoin de calme pour un bon endormissement. Ensuite, le contenu même des réseaux agite le cerveau. Les sollicitations, les échanges qui n’en finissent pas, les conversations prenantes peuvent provoquer du stress à un moment où on en a le moins besoin. […]
La pratique des réseaux sociaux peut également engendrer de l’anxiété et du stress dans la journée. L’impossibilité de consulter son fil Twitter ou Facebook parce qu’on est en réunion ou au volant peut déclencher une bonne crise de fomo [i.e. : peur d’être coupé de son portable]. Ce qu’on lit sur les réseaux peut également provoquer de la contrariété […].
Paradoxalement, les réseaux sociaux favoriseraient le sentiment d’isolement et de solitude. C’est ce qui ressort d’une étude américaine menée en 2014 [Brian A. Primack, Social media use and percieving social isolation among young adults in the US, University of Pittsburgh, 2014]. Les personnes pratiquant le Web 2.0 plus de deux heures pa jour se sentiraient deux fois plus isolées que celles qui n’y consacrent pas plus d’une demi-heure au quotidian.
[…]
Selon une étude britannique de la Société royale de santé publique, Instagram, avec ses milliers de photos retouchées prônant la perfection physique, serait le réseau social qui nuit le plus aux jeunes. D’après cette étude, sept jeunes sur dix reconnaissent qu’Instagram les fait se sentir mal dans leur peau, suscite un sentiment d’envie, d’infériorité, et donne l’impression de rater sa vie.
[…]
Selon une grande étude réalisée par des psychologues des universités de San Diego et de Floride, les adolescents branchés sur leurs smartphones plus de cinq heures par jour ont 66% de risque supplémentaire de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu’une heure quotidienne aux écrans. »
Les auteurs de l'étude définissent l'addiction au smartphone ainsi : une envie constante de se servir de l'objet, pouvant se traduire par une sensation de mal-être en cas de privation. « Il y a un problème quand les gens dépendent tellement de l'appareil qu'ils peuvent se sentir anxieux s'ils n'y ont pas accès et qu'ils l'utilisent au détriment de leur vie quotidienne », estime Matthew Lapierre, professeur assistant au département de communication de l'université d'Arizona et auteur principal de l'étude.
Le Pr Lapierre et son équipe ont interrogé 346 adolescents en deux temps, sur une période totale de 3 mois. Publiée dans le Journal of Adolescent Health, l'étude a sélectionné des participants âgés de 17 à 20 ans. Les chercheurs ont proposé aux volontaires d'évaluer leur sentiment de manque sur une échelle de 1 à 4, en répondant à une série d'énoncés, tels que « Je panique lorsque je ne peux pas utiliser mon smartphone ». Les participants ont également répondu à des questions conçues pour jauger leur sentiment de solitude, leurs symptômes dépressifs et la fréquence d'utilisation de leur téléphone.
En analysant les réponses des volontaires, les chercheurs ont constaté qu'une forte dépendance au smartphone était liée à des risques accrus de développer des symptômes dépressifs et de solitude. Leurs recherches confirment donc ce qui a été démontré dans plusieurs études antérieures : à savoir qu'un usage intensif du smartphone a tendance à isoler et à favoriser l'anxiété.
À la lumière de ces résultats, les auteurs de l'étude estiment qu'il pourrait être utile pour les personnes concernées d'évaluer leur relation avec leurs appareils et de s'imposer des limites si nécessaire. « Si quelqu'un recourt à son smartphone comme rempart contre le stress, il peut par exemple tenter d'autres approches plus saines, comme parler à un ami proche pour obtenir du soutien ou faire des exercices de méditation », suggère le chercheur Pengfei Zhao, co-auteur de l'étude."
(Source : futura-sciences.com)
Nous n’avons certes pas la compétence suffisante pour trancher le débat de savoir si le terme « addiction », dans son acception médicale, est correcte lorsqu’il s’agit d’Internet ; cependant, tous les documents que nous avons pu consulter montre que le medium, et en particulier les réseaux sociaux, poussent les personnes fragiles à des comportements délirants – que penser alors des anciens cadres repentis des GAFAM, évoqués par Sciences et avenir, qui se mettent à alerter à leur tour l’opinion des dangers des réseaux qui les ont enrichis ?
« Quelle est la première chose que vous faites le matin après vous être réveillé ? En 2016, pour un Français sur 5, il s'agissait déjà de regarder son téléphone portable. En moyenne, nous regardons nos smartphones plus de 26 fois par jour, selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte. Outre-Atlantique, des anciens de Facebook ou de Google s'inquiètent de ce système qu'ils ont participé à concevoir. Ils décrient notamment l'addiction provoquée de façon délibérée par ces réseaux sociaux pour que les internautes passent toujours plus de temps en ligne, ce qu'on appelle économie de l'attention. Ces repentis ont créé le Centre pour une technologie humaine (Center for Humane Technology), qui va financer à hauteur de 7 millions de dollars une campagne médiatique aux États-Unis. L'objectif : informer les enfants et leurs parents des dangers découlant de l'usage des technologies, et notamment des réseaux sociaux.
"Facebook détruit le tissu social"
Ces anciens de la Tech qui désormais la critiquent, qui sont-ils ? L'initiative est largement fédérée par Tristan Harris, son co-fondateur, ancien éthicien chez Google. Celui-ci s'était fait connaître en 2014, en critiquant l'économie de la distraction promue par les réseaux (voir sa vidéo à TEDxBrusels). "Nous étions à l'intérieur, nous savons bien ce que mesurent les géants de la Tech et où se place l'ingénierie", a indiqué Tristan Harris dans les colonnes du New York Times (en anglais). En décembre 2017, un ancien dirigeant de Facebook, Chamath Palihapitiya, estimait pour sa part que le réseau social "détruisait le tissu social de la société" (lien en anglais). Et ce n'est pas tout : on compte aussi parmi les membres fondateurs Justin Rosenstein, l'inventaire du fameux bouton "J'aime" de Facebook.
ENFANTS. L'impact social est au cœur de l'initiative. "La course pour l'attention est en train de détruire les piliers de notre société : notre santé mentale, nos enfants, nos relations sociales et même la démocratie", peut-on lire sur son site. "Ce qui est bon pour retenir notre attention n'est pas bon pour notre bien-être : Snapchat redéfinit la façon dont nos enfants mesurent l'amitié." La campagne médiatique va ainsi cibler 55.000 écoles publiques aux États-Unis. Car l'inquiétude gagne : "Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau des enfants", s'était alarmé Sean Parker, l'un des premiers investisseurs à miser sur le réseau social (lien en anglais).
La santé des GAFA au beau fixe
Roger McName, ancien conseiller de Mark Zuckerberg lors des débuts de Facebook, a dit au New York Times qu'il était horrifié. "Facebook cible votre cerveau reptilien, celui qui réagit à la peur et à la colère. Et avec les smartphones, Facebook peut bénéficier de votre attention à chaque instant", a-t-il indiqué. Mais il n'empêche que la santé d'Amazon, de Google ou de Facebook n'a jamais été aussi bonne (lien en anglais) : le chiffre d'affaires d'Apple a grimpé de 13%, il est également en hausse chez Facebook. Pas dit que dans ces conditions, les géants de la Tech soient vraiment prêts à tendre l'oreille... »
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




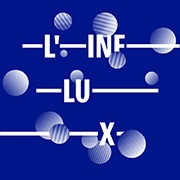 Bambois
Bambois