Question d'origine :
Bonjour, je me demandais quelle est la définition de "Femme" et d'"Homme" en prenant en compte le fait qu'un femme transgenre est une femme même si elle n'a pas subi d'opérations sexuelles. et inversement pour les hommes transgenre. Je me pose le question parce que ces mots semblent simples mais en réalité ils ont l'air extrêmement compliqués à definir.
Merci d'avance \(^-^)/
Réponse du Guichet
Le 30/10/2018 à 16h29
Bonjour,
Ce qu'on appelle homme et femme sont des extrapolations culturelles à partir de la biologie de la reproduction. Les attitudes et aptitudes attendues, les stéréotypes du masculin et du féminin, sont variables selon les sociétés. En cela le travail de Marguerite Mead, qui fit polémique, fut fondateur sur la problématique avec notamment la publication de Mœurs et sexualité en Océanie.
En Occident, en médecine, on définit le sexe selon un assemblage de critères censés converger : morphotype, caractères sexuels primaires, secondaires, anatomie interne et hormones (et jusqu'à récemment psychologie). Il s'avère que la nature dépasse cette bipolarité, comme on le voit avec les personnes autrefois dites "hermaphrodites", à présent dénommées intersexes. Dans certaines cultures, ces personnes forment un troisième genre socialement reconnu et très respecté (Nadle chez les Navajo) ou, au contraire, dévalorisé (Serrer chez les Pokot, turnim man chez les Sambia)
Sur ces questions, vous pourrez notamment lire Gender Reversals and Gender Cultures: Anthropological and Historical perspectives ou Third sex, third gender [Livre] : beyond sexual dimorphism in culture and history de Gilbert Herdt.
Dans d'autres cas, il existe un troisième genre, sans lien avec la biologie comme on peut le constater sur les sipiniiq chez les Inuits, étudiés par Saladin d'Anglure dans Etre et renaître inuit, homme, femme ou chamane.
Chez nous, on réassigne les nourrissons intersexués à la naissance ou au cours de la croissance (selon les cas) pour les conformer, via la chirurgie et l'endocrinologie, à l'un des deux pôles : homme / femme. Au-delà des personnes intersexes, parmi les personnes ayant adopté un genre autre que celui assigné à la naissance, toutes ne s’identifient pas comme transgenres (FtM / MtF… FtU ou MtU, c-a-d M ou F to Unknown) : certaines s’identifient comme femme ou homme sans référence à la notion de « trans ». Le terme de transgenre est généralement approprié par des personnes
Pour approfondir la question, nous vous conseillons de lire les ouvrages d’Anne Fausto-Sterling qui pose la question de savoir pourquoi il n’y aurait que deux sexes. Nous vous conseillons notamment :
• Corps en tous genres: la dualité des sexes à l'épreuve de la science / Anne Fausto-Sterling ; traduit de l'anglais (américain) par Oristelle Bonis et Françoise Bouillot ; préface de l'auteure à l'édition française ; postface d'Évelyne Peyre, Catherine Vidal et Joëlle Wiels, 2012 : "Il y a deux sexes !" Ce serait un fait de nature. La biologiste Anne Fausto-Sterling défait cette fausse évidence du sens commun, fut-il scientifique. N'y en aurait-il pas cinq, voire plus ? Ironique, cette proposition n'en est pas moins sérieuse : pour les intersexes, ni tout à fait garçons ni vraiment filles, il en va de leur vie. Va-t-on les faire entrer de force, par la chirurgie, dans l'une ou l'autre catégorie ? Et, quand ils envoient des messages différents, qui, des chromosomes, des hormones, du cerveau ou du squelette, a le dernier mot ? L'enjeu, ce sont les exceptions mais aussi la règle, à savoir tout le monde ! Le partage entre deux sexes est toujours une opération sociale. C'est bien la société qui tranche dans les variations attestées pour donner un sexe au corps. Et, quand le médecin ou le savant parlent sexe, ou sexualité, c'est encore la société que l'on entend. Loin d'être neutre, la science est donc toujours située : telle est l'une des leçons de cet ouvrage, devenu un classique depuis sa publication aux Etats-Unis en 2000. La critique du biologisme par une scientifique du sérail trouble nos oppositions convenues - entre genre (social) et sexe (biologique), entre culture et nature. Ainsi ne pourra-t-on plus dire qu'il faut choisir entre féminisme et science. Gai savoir que celui offert par ce livre illustré avec humour et érudition : la biologie, c'est bien la politique continuée par d'autres moyens".
• Les cinq sexes : pourquoi mâle et femelle ne suffisent pas / Anne Fausto-Sterling ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Boterf ; préface de Pascale Molinier, 2013 :" Deux articles dans lesquels, s'appuyant sur l'exemple des hermaphrodites, la biologiste et spécialiste du genre démontre l'association de facteurs biologiques et sociaux dans la définition de l'identité sexuelle".
Par ailleurs, en 2011, Thierry Hocquet, maître de conférences, donnait une conférence sur : «L'homme de demain a-t-il un sexe ? dans laquelle il s’interrogeait sur qu’être « homme ou femme aujourd’hui, quand la chirurgie rend possible de décider soi-même de son sexe ? Notre identité sexuelle nous semble biologiquement déterminée mais voici que nous pouvons artificiellement changer ce que la nature a créé. La différence sexuelle ne va pas de soi : elle est un produit historique qui n’a pas toujours été pensé de la même façon."
Vous trouverez d’autres considérations sur la question dans :
• Masculin-féminin : pluriel/ sous la direction de Martine Fournier, 2014 : "Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Existe-t-il un "troisième" genre ? D'où nous vient en réalité notre identité sexuelle ? De nos gènes, des hormones, de notre éducation et de notre culture, de nos goûts ? Cette question est aujourd'hui plus que jamais sur la sellette. D'une part, parce que les évolutions sociales donnent à voir des identités de sexe de plus en plus diversifiées où la part du féminin et du masculin varie selon les individus. Mais aussi parce que ces questions engendrent dans l'opinion de nombreux amalgames et de virulentes polémiques. L'objectif de ce livre est justement d'apporter une clarification sur le sujet. Quelles sont les théories en présence lorsqu'il s'agit d'expliquer les différences hommes-femmes, les orientations sexuelles, le phénomène des transgenres ? En quoi consistent justement les études sur le genre qui se sont multipliées depuis deux décennies ? Et finalement, quel bilan peut-on tirer aux vues des avancées scientifiques les plus récentes ? La parole est donnée aux psychologues, anthropologues, sociologues, philosophes et même aux neuroscientifiques qui ont tous apporté leur pierre à ce débat. Mais c'est aussi de l'évolution du statut et des rôles sociaux de chacun des sexes dont il sera question. Depuis un demi-siècle, les transformations sociales et les progrès de la démocratie questionnent la place des deux sexes aussi bien dans la sphère publique que privée. Pourquoi les femmes sont-elles été tenues, depuis la nuit des temps et dans toutes les sociétés, dans un statut d'infériorité sociale ? Pourquoi, dans les démocraties les plus avancées, des inégalités et certains stéréotypes semblent résister ? Et, quoi qu'il en soit, dans quelle mesure ces changements induisent-ils une transformation des identités aussi bien féminines que masculines".
• Féminin, masculin : mythes et idéologies/ sous la direction de Catherine Vidal, 2015 :" Etude pluridisciplinaire sur les fondements des identités féminine et masculine, qui fait appel aux sciences dures comme aux sciences humaines à travers les regards d'une philosophe, d'une psychologue, d'une sociologue, d'une généticienne, d'une neurobiologiste et d'anthropologues".
En guise de conclusion, nous vous laissons parcourir les bibliographies proposées par le Point G, centre de ressources sur le Genre de la bibliothèque municipale de Lyon sur les notions de genre et les masculinites.
Ce qu'on appelle homme et femme sont des extrapolations culturelles à partir de la biologie de la reproduction. Les attitudes et aptitudes attendues, les stéréotypes du masculin et du féminin, sont variables selon les sociétés. En cela le travail de Marguerite Mead, qui fit polémique, fut fondateur sur la problématique avec notamment la publication de Mœurs et sexualité en Océanie.
En Occident, en médecine, on définit le sexe selon un assemblage de critères censés converger : morphotype, caractères sexuels primaires, secondaires, anatomie interne et hormones (et jusqu'à récemment psychologie). Il s'avère que la nature dépasse cette bipolarité, comme on le voit avec les personnes autrefois dites "hermaphrodites", à présent dénommées intersexes. Dans certaines cultures, ces personnes forment un troisième genre socialement reconnu et très respecté (Nadle chez les Navajo) ou, au contraire, dévalorisé (Serrer chez les Pokot, turnim man chez les Sambia)
Sur ces questions, vous pourrez notamment lire Gender Reversals and Gender Cultures: Anthropological and Historical perspectives ou Third sex, third gender [Livre] : beyond sexual dimorphism in culture and history de Gilbert Herdt.
Dans d'autres cas, il existe un troisième genre, sans lien avec la biologie comme on peut le constater sur les sipiniiq chez les Inuits, étudiés par Saladin d'Anglure dans Etre et renaître inuit, homme, femme ou chamane.
Chez nous, on réassigne les nourrissons intersexués à la naissance ou au cours de la croissance (selon les cas) pour les conformer, via la chirurgie et l'endocrinologie, à l'un des deux pôles : homme / femme. Au-delà des personnes intersexes, parmi les personnes ayant adopté un genre autre que celui assigné à la naissance, toutes ne s’identifient pas comme transgenres (FtM / MtF… FtU ou MtU, c-a-d M ou F to Unknown) : certaines s’identifient comme femme ou homme sans référence à la notion de « trans ». Le terme de transgenre est généralement approprié par des personnes
Pour approfondir la question, nous vous conseillons de lire les ouvrages d’Anne Fausto-Sterling qui pose la question de savoir pourquoi il n’y aurait que deux sexes. Nous vous conseillons notamment :
• Corps en tous genres: la dualité des sexes à l'épreuve de la science / Anne Fausto-Sterling ; traduit de l'anglais (américain) par Oristelle Bonis et Françoise Bouillot ; préface de l'auteure à l'édition française ; postface d'Évelyne Peyre, Catherine Vidal et Joëlle Wiels, 2012 : "Il y a deux sexes !" Ce serait un fait de nature. La biologiste Anne Fausto-Sterling défait cette fausse évidence du sens commun, fut-il scientifique. N'y en aurait-il pas cinq, voire plus ? Ironique, cette proposition n'en est pas moins sérieuse : pour les intersexes, ni tout à fait garçons ni vraiment filles, il en va de leur vie. Va-t-on les faire entrer de force, par la chirurgie, dans l'une ou l'autre catégorie ? Et, quand ils envoient des messages différents, qui, des chromosomes, des hormones, du cerveau ou du squelette, a le dernier mot ? L'enjeu, ce sont les exceptions mais aussi la règle, à savoir tout le monde ! Le partage entre deux sexes est toujours une opération sociale. C'est bien la société qui tranche dans les variations attestées pour donner un sexe au corps. Et, quand le médecin ou le savant parlent sexe, ou sexualité, c'est encore la société que l'on entend. Loin d'être neutre, la science est donc toujours située : telle est l'une des leçons de cet ouvrage, devenu un classique depuis sa publication aux Etats-Unis en 2000. La critique du biologisme par une scientifique du sérail trouble nos oppositions convenues - entre genre (social) et sexe (biologique), entre culture et nature. Ainsi ne pourra-t-on plus dire qu'il faut choisir entre féminisme et science. Gai savoir que celui offert par ce livre illustré avec humour et érudition : la biologie, c'est bien la politique continuée par d'autres moyens".
• Les cinq sexes : pourquoi mâle et femelle ne suffisent pas / Anne Fausto-Sterling ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Emmanuelle Boterf ; préface de Pascale Molinier, 2013 :" Deux articles dans lesquels, s'appuyant sur l'exemple des hermaphrodites, la biologiste et spécialiste du genre démontre l'association de facteurs biologiques et sociaux dans la définition de l'identité sexuelle".
Par ailleurs, en 2011, Thierry Hocquet, maître de conférences, donnait une conférence sur : «L'homme de demain a-t-il un sexe ? dans laquelle il s’interrogeait sur qu’être « homme ou femme aujourd’hui, quand la chirurgie rend possible de décider soi-même de son sexe ? Notre identité sexuelle nous semble biologiquement déterminée mais voici que nous pouvons artificiellement changer ce que la nature a créé. La différence sexuelle ne va pas de soi : elle est un produit historique qui n’a pas toujours été pensé de la même façon."
Vous trouverez d’autres considérations sur la question dans :
• Masculin-féminin : pluriel/ sous la direction de Martine Fournier, 2014 : "Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Existe-t-il un "troisième" genre ? D'où nous vient en réalité notre identité sexuelle ? De nos gènes, des hormones, de notre éducation et de notre culture, de nos goûts ? Cette question est aujourd'hui plus que jamais sur la sellette. D'une part, parce que les évolutions sociales donnent à voir des identités de sexe de plus en plus diversifiées où la part du féminin et du masculin varie selon les individus. Mais aussi parce que ces questions engendrent dans l'opinion de nombreux amalgames et de virulentes polémiques. L'objectif de ce livre est justement d'apporter une clarification sur le sujet. Quelles sont les théories en présence lorsqu'il s'agit d'expliquer les différences hommes-femmes, les orientations sexuelles, le phénomène des transgenres ? En quoi consistent justement les études sur le genre qui se sont multipliées depuis deux décennies ? Et finalement, quel bilan peut-on tirer aux vues des avancées scientifiques les plus récentes ? La parole est donnée aux psychologues, anthropologues, sociologues, philosophes et même aux neuroscientifiques qui ont tous apporté leur pierre à ce débat. Mais c'est aussi de l'évolution du statut et des rôles sociaux de chacun des sexes dont il sera question. Depuis un demi-siècle, les transformations sociales et les progrès de la démocratie questionnent la place des deux sexes aussi bien dans la sphère publique que privée. Pourquoi les femmes sont-elles été tenues, depuis la nuit des temps et dans toutes les sociétés, dans un statut d'infériorité sociale ? Pourquoi, dans les démocraties les plus avancées, des inégalités et certains stéréotypes semblent résister ? Et, quoi qu'il en soit, dans quelle mesure ces changements induisent-ils une transformation des identités aussi bien féminines que masculines".
• Féminin, masculin : mythes et idéologies/ sous la direction de Catherine Vidal, 2015 :" Etude pluridisciplinaire sur les fondements des identités féminine et masculine, qui fait appel aux sciences dures comme aux sciences humaines à travers les regards d'une philosophe, d'une psychologue, d'une sociologue, d'une généticienne, d'une neurobiologiste et d'anthropologues".
En guise de conclusion, nous vous laissons parcourir les bibliographies proposées par le Point G, centre de ressources sur le Genre de la bibliothèque municipale de Lyon sur les notions de genre et les masculinites.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Pourquoi ne peut-on pas lire la presse en ligne (europresse)...
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




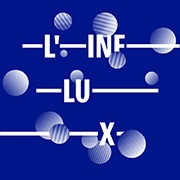 Foot la machine à broyer
Foot la machine à broyer