"Grand homme"
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 02/01/2017 à 12h57
466 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Je recherche de la littérature sur la création/fabrication des "grands hommes" ? Comment un homme devient un "grand homme"? En fait, qu'est ce qu'un "grand homme"?
Je ne sais pas s'il faut me tourner vers la philosophie ou l'histoire ou la sociologie ou les trois... (?)
Merci d'avance!
Réponse du Guichet
Le 04/01/2017 à 11h29
Bonjour,
Nous laissons de côté ce qui concerne le Panthéon, pour lequel nous vous avons déjà fourni une bibliographie dans notre réponse précédente.
« Aux héros de l'histoire et de la culture classiques, marquées par l'héritage antique, les Lumières ont opposé la supériorité des grands hommes, même si elles mettent aussi l'accent sur les structures politiques et les évolutions profondes de la société et de l'économie. Au début du XIXe siècle, où le héros est de retour avec le romantisme, historiens et philosophes tiennent toujours grands hommes et hommes supérieurs pour les agents majeurs de l'Histoire. Mais la construction de leur image résulte autant d'un héritage de faits, dont ils ont été responsables, que de sa lecture idéologique. Donc d'une approche du passé qu'une vision du monde - un système de principes et de valeurs - interprète, en termes finalistes, à travers les enjeux du présent et les attentes d'un futur. Reconnaître une individualité supérieure signifie donc que son action et sa pensée cautionnent un sens de l'Histoire. Mais dans ces échanges - constants et complexes - entre passé et présent que de jugements contradictoires lorsque sa légitimité est discutée. Au point que la destinée posthume d'un grand homme peut peser plus que sa vie réelle, ce qui brouille son statut historique. »
Source : Jean-François Jacouty, « Robespierre selon Louis Blanc. Le prophète christique de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 331 | 2003, 103-125.
Pour approfondir la notion de « grand homme » en philosophie de l’histoire, nous vous proposons de vous plonger dans le numéro de la revue Romantisme entièrement consacré au grand homme du XIXe siècle.
L’ouvrage de Pierre-Jean Dufief, L’écrivain et le grand homme, s’intéresse au processus de glorification à travers la littérature.
Dans l’ouvrage Histoires universelles et philosophies de l’histoire, le chapitre 10 écrit par Christophe Bouton est consacré aux grands hommes : Splendeurs et misères du grand homme.
Voici le résumé que nous trouvons sur Cairn :
« L’homme est-il l’instrument de l’esprit du monde ou joue-t-il un rôle spécifique, irréductible, qui permette de le considérer comme acteur et auteur des événements ? Les philosophies de l’histoire ont-elles vraiment dénié à l’homme toute prétention à être l’auteur des événements dont il est l’acteur ? Quel est, au juste, le sens de la distinction entre auteur et acteur ? Et qu’est-ce qu’une action dont l’acteur ne serait pas l’auteur ? Christophe Bouton tente de répondre à ces différentes questions en portant son attention sur la figure du « grand homme », du héros de l’histoire auquel un certain nombre de penseurs et de courants historiques n’ont reconnu aucun pouvoir sur le cours de l’histoire, quand d’autres lui attribuent au contraire un rôle majeur. La théorie hégélienne du grand homme qui sert de base à sa réflexion est sur ce point loin d’être univoque. »
Bonnes lectures.
Nous laissons de côté ce qui concerne le Panthéon, pour lequel nous vous avons déjà fourni une bibliographie dans notre réponse précédente.
« Aux héros de l'histoire et de la culture classiques, marquées par l'héritage antique, les Lumières ont opposé la supériorité des grands hommes, même si elles mettent aussi l'accent sur les structures politiques et les évolutions profondes de la société et de l'économie. Au début du XIXe siècle, où le héros est de retour avec le romantisme, historiens et philosophes tiennent toujours grands hommes et hommes supérieurs pour les agents majeurs de l'Histoire. Mais la construction de leur image résulte autant d'un héritage de faits, dont ils ont été responsables, que de sa lecture idéologique. Donc d'une approche du passé qu'une vision du monde - un système de principes et de valeurs - interprète, en termes finalistes, à travers les enjeux du présent et les attentes d'un futur. Reconnaître une individualité supérieure signifie donc que son action et sa pensée cautionnent un sens de l'Histoire. Mais dans ces échanges - constants et complexes - entre passé et présent que de jugements contradictoires lorsque sa légitimité est discutée. Au point que la destinée posthume d'un grand homme peut peser plus que sa vie réelle, ce qui brouille son statut historique. »
Source : Jean-François Jacouty, « Robespierre selon Louis Blanc. Le prophète christique de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 331 | 2003, 103-125.
Pour approfondir la notion de « grand homme » en philosophie de l’histoire, nous vous proposons de vous plonger dans le numéro de la revue Romantisme entièrement consacré au grand homme du XIXe siècle.
L’ouvrage de Pierre-Jean Dufief, L’écrivain et le grand homme, s’intéresse au processus de glorification à travers la littérature.
Dans l’ouvrage Histoires universelles et philosophies de l’histoire, le chapitre 10 écrit par Christophe Bouton est consacré aux grands hommes : Splendeurs et misères du grand homme.
Voici le résumé que nous trouvons sur Cairn :
« L’homme est-il l’instrument de l’esprit du monde ou joue-t-il un rôle spécifique, irréductible, qui permette de le considérer comme acteur et auteur des événements ? Les philosophies de l’histoire ont-elles vraiment dénié à l’homme toute prétention à être l’auteur des événements dont il est l’acteur ? Quel est, au juste, le sens de la distinction entre auteur et acteur ? Et qu’est-ce qu’une action dont l’acteur ne serait pas l’auteur ? Christophe Bouton tente de répondre à ces différentes questions en portant son attention sur la figure du « grand homme », du héros de l’histoire auquel un certain nombre de penseurs et de courants historiques n’ont reconnu aucun pouvoir sur le cours de l’histoire, quand d’autres lui attribuent au contraire un rôle majeur. La théorie hégélienne du grand homme qui sert de base à sa réflexion est sur ce point loin d’être univoque. »
Bonnes lectures.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




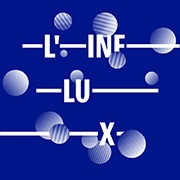 Extraterrestres
Extraterrestres