Quelles raisons ont conduit Antonin de Nisibe à trahir Rome au profit des Perses ?
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le livre Ammien Marcellin, livres XVII - XIX, édité par Les Belles Lettres (n° d'édition 11091), les raisons ayant conduit Antoninus de Nisibe à trahir Rome au profit des Perses sont brièvement explicitées dans la note 165 page196. Son refus de s'acquitter d'une sitégie est la source de tous ses maux. Une sitégie fait partie des charges curiales, mais de quelle nature et de quelle étendue ? C'est une histoire d'argent certes mais encore...
Merci par avance,
mrcbrsr
Réponse du Guichet
Il semble que dans cette obscure histoire de charges curiales dans l’Empire romain d’orient, les sources principales, Ammien Marcellin et Libanius, ne permettent pas d’éclaircir l’étendue et la nature exacte de cette «sitegia». Les questionnements du principal commentateur, Paul Petit, porte plutôt justement sur l’exceptionnalité du cas Antoninus.
Bonjour,
En fait, la note des Éditions Belles Lettres de Guy Sabbah est un peu plus longue et explicite que vous ne le mentionnez :
«Antoninus de Nisibe était un gros commerçant que ses affaires mettaient sans doute en relation avec les Perses[…]. En tant que marchand, il échappait légalement aux obligations des curiales, qui sont les propriétaires fonciers; mais les curiales devenant rares, on en vint à imposer des liturgies extraordinaires aux riches, non curiales ; c’est ainsi qu’Antoninus dut s’acquitter d’une sitégie pour le ravitaillement en blé d’Antioche. Mais il refusa d’en exécuter une seconde; et voyant que sa qualité de marchand ne le mettait pas à l’abri des charges curiales, il crut trouver refuge plus sûr en devenant «officier d’administration chargé des finances» […]. Mais il fut poursuivi pour n’avoir pas exécuté la deuxième sitégie par les potentes, c’est-à-dire les curiales les plus importants de Nisibe. D’après Libanius, il céda ses biens à plus riche que lui […]D’après Ammien, Antoninus fut condamné à de très grosses amendes et reconnut sa dette mais les sommes dues aux curiales qui avaient été obligés de supporter les frais du ravitaillement esquivé par Antoninus, avaient été portées au bénéfice du fisc par collusion entre les grands curiales et l’administration impériale : les poursuites seraient ainsi exercées contre Antoninus avec une plus grande énergie, puisque l’État serait le poursuivant.»
C’est aussi ce que résume le texte La traversée de la frontière par les émigrants en fuite selon Ammien Marcellin, de Ekaterina Nechaeva sur Researchgate (Antoninus, p. 92 à 99).
Cette note recommandant aussi, pour plus de détails, l’ouvrage: Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C de Paul Petit (recension sur Persée), aux pages 160-161, en voici quelques extraits les plus significatifs pour votre question:
«Libanius est le seul à notre connaissance à nous parler de la «sitegia», un transport de blé effectué pour le service de l’état. […]. Le travail consiste d’abord à surveiller sur place, c’est-à-dire en Egypte, le chargement du blé, et ensuite à convoyer soi-même la cargaison, dont la destination paraît être en général Constantinople: le blé sert à «nourrir l’empereur, l’armée et les capitales.». […]
Nous avons reconnu une dizaine de textes qui nous renseignent sur la sitegia. Trois d’entre eux , datant de 363, de 388 et de 390, permettent de conclure à une charge curiale. […] les quatre derniers nous obligent à reconsidérer apparemment la question, car la sitegia y est exécutée par des personnages qui ne sont certainement pas des curiales.»
Parmi ces quatre derniers textes figure l'histoire d'Antoninus :
«En 358, un riche marchand, Antoninus, est le héros d’une étrange aventure, dont nous connaissons le début par une lettre de Libanius, et le dénouement par Ammien. Chargé une première fois d’une sitegia, Antoninus refusa d’en exécuter une seconde, et préféra, d’après Libanius, donner ses biens à d’autres, plus riches que lui; d’après Ammien, il fit semblant de les verser au fisc. Enfin, sans doute dégoûté ou menacé, il trahit la cause romaine, se réfugia chez les Perses et leur servit de conseiller. Cet individu n’était ni naviculaire, ni curiale, car il n’aurait eu aucun prétexte pour refuser une charge parfaitement normale dans l’un et l’autre cas, puisque la sitegia est un transport par mer et une liturgie.
[…]
La sitegia est donc apparemment un munus personale, ainsi que Le Digeste, L, 4, 18,3 qualifie la prosecutio annonae, mais d’une part elle est parfois applicable à des non curiales, c’est-à-dire en fait à des possessores, et c’est alors un munus extraordinarium, ou possessionis; et d’autre part elle apparaît comme une «liturgie», la «liturgie du navire», c’est-à-dire comme un munus patrimonii, entraînant des dépenses ou une responsabilité pécuniaire. […]
Un munus patrimonii peut être évité si le récalcitrant se prête à la cessio bonorum, c’est-à-dire s’il transmet sa fortune à un autre qui le remplacera.»
Devant la contradiction des deux textes sources Paul Petit conclut :
«Il est probable en réalité qu’il fut condamné à verser une grosse somme au fisc pour ne pas avoir accompli sa mission: en effet c’est à un fonctionnaire appartenant aux services du comes sacrum largitonum que Libanius adresse une lettre en sa faveur. S’il n’y a pas cession de biens, nous sommes en revanche sur la voie qui conduira le législateur à bloquer les avoirs des naviculaires: si la sitegia n’était vraiment qu’un munus personale, le défaillant eût été frappé, emprisonné, mais n’eût pas été condamné à une amende.»
Ces extraits peuvent nous aider à comprendre que les textes ne permettent pas de percevoir une quelconque étendue de la dette d’Antoninus, mais poussent plutôt à s’interroger sur cette sitegia rarement mentionnée.
C’est ainsi d’ailleurs que l’auteur clôt son chapitre:
«Que peut-on conclure de cette étude? La sitegia est une charge que les curiales supportent en temps normal […]
D’autre part, elle conserve un caractère exceptionnel, car les nécessités du ravitaillement peuvent devenir impérieuses en cas de disette, de concentration de troupes en vue d’une campagne, etc.: d’où la tendance à l’attribuer à certains moments à tout possessor, comme un munus extraordinarium, lorsque les naviculaires ne peuvent suffire aux transports maritimes. Ce fut le cas en 358, lors des préparatifs de Constance en vue de la campagne perse (affaire d’Antoninus et prestation volontaire de Julianus) […] La sitegia, qui semble rare en temps normal, est donc susceptible de prendre l’aspect d’une réquisition brutale.[…].»
Étudiant un autre texte (cas de Julianus) évoquant la même année, Paul Petit constate qu’à l’époque la sitegia est organisée, le travail n’est pas rémunéré, pénible, mais pas encore dispendieux car le navire est réquisitionné par l’état et mis à la disposition du convoyeur.
«La sitegia est à cette époque une simple prosecutio annonae, mais par mer».
Paul Petit se lance alors dans une interprétation toute personnelle :
«On sait qu’Antoninus devait trahir la cause romaine. Ses accointances avec les Perses étaient certainement antérieures à ses démêlés avec les potentes et le fisc: c’était un partisan des Perses, à tout le moins un «neutraliste», comme nous dirions aujourd’hui. Il est séduisant en ce cas de penser que la sitegia qu’il refusa devait être destinée à ravitailler l’armée romaine d’invasion: exemple unique (?) dans l’Antiquité d’une «objection de conscience», poussée jusqu’au sabotage, puis à la trahison?»
Consultez également Les élites urbaines d’Antioche et de Syrie du Nord au IVe siècle, Bernadette Cabouret, Topoi. Orient-Occident, Année 2007, 15-1 pp. 319-341
Et la source apparemment incontournable que sont les œuvres de Libanius.
Bonnes lectures !




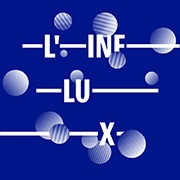 Mohammed V
Mohammed V