Quel est le rôle des familles défavorisées dans l'orientation scolaire de leurs enfants ?
Question d'origine :
Quel est le rôle des familles défavorisées dans l'orentation scolaire de leurs enfants?
Réponse du Guichet
Le rôle des familles dans l'orientation est important mais doit être englobé dans des réflexions prenant en compte tout un écosystème.
Bonjour,
Depuis les années 1970, les sociologues se sont intéressés au lien entre inégalités sociales et échec scolaire et il existe de très nombreuses études abordant cette question. Le sujet a même été traité dans les annales du bac. Pour autant, les récentes études montrent aussi qu’au-delà d’une appartenance de classe d’origine, les effets des normes et des pratiques éducatives familiales ont aussi des conséquences sur les carrières scolaires des élèves et qu’il faut donc repenser le sujet de l’école (et de l’orientation) et des familles dans un écosystème.
Tout d’abord, pourleco.com revient sur les conséquences des inégalités sur les orientations :
« On parle beaucoup d’Affelnet, de Parcoursup, de ce qui se joue au lycée, mais les inégalités d’orientation interviennent, dans le système français, dès le collège », explique Nina Guyon, chercheuse spécialisée en économie de l’éducation.
Par rapport à un élève issu d’un milieu favorisé, un élève de troisième issu d’un milieu populaire a 93 % plus de chances d’être orienté vers une seconde professionnelle, 169 % vers un CAP et 74 % moins de chances de redoubler qu’un élève de milieu favorisé ayant les mêmes résultats scolaires.
L’opinion familiale joue un rôle important. Pour réduire les différences sociales d’orientation chez les élèves les moins performants, il faudrait revaloriser la voie professionnelle et le CAP aux yeux des familles favorisées, qui veulent éviter le CAP.
Mais les inégalités sociales ne peuvent seules expliquer ces différences comme le relèvent les autrices, Marie Duru-Bellat, Géraldine Farges, Agnès van Zanten ("les pratiques éducatives des familles dans Sociologie de l'école, 2022, p. 201-229) :
Ces normes et ces pratiques s’avèrent plus prédictives des destinées scolaires que l’origine sociale, même s’il existe une forte corrélation entre ces deux variables. Leur analyse est d’autant plus importante que, dans un mode de reproduction sociale à dominante scolaire (Bourdieu et Passeron, 1970), toutes les familles, des plus favorisées aux plus défavorisées, se trouvent obligées de définir des stratégies éducatives et de s’organiser en conséquence.
Par ailleurs, dans Inégalités scolaire et orientation : les enjeux des territoires, Nadia Nakhili explique que :
les enfants de milieu populaire réussissent moins bien que ceux d’origine sociale favorisée, en particulier en raison de difficultés constatées dès l’entrée au primaire se cumulant année après année. Au total, les enfants d’origine sociale défavorisée se présentent dès la fin du collège avec des possibilités d’orientation différentes que les jeunes d’origine sociale favorisée au palier d’orientation de fin de 3ème. Ainsi, ces différences de réussite entraînent des orientations dans des cursus différents ce qui participe à la différenciation des parcours. Mais au-delà de ces différences des possibles, à chaque palier d’orientation, des élèves aux résultats comparables n’accèdent pas aux mêmes filières ; dans ce cas, c’est l’orientation qui est à l’origine de ces différences de nouveau à travers deux mécanismes les différences d’aspirations puis de choix d’études d’une part et les inégalités relatives à la sélection scolaire d’autre part.
Ahmed Tritah note que "De nombreux facteurs influencent la réussite sociale. Certains sont innés, d’autres hérités, tels que l’environnement social et familial. Les ressources et l’organisation du système éducatif jouent un rôle important, de même que l’investissement des parents et les efforts d’apprentissage des enfants".
Source : “Inégalité et Mobilité Sociale: Le Rôle Du Financement de l’éducation.” Revue Économique, vol. 70, no. 5, 2019, pp. 819–46.
Les inégalités sociales sont un des freins à des choix ambitieux. Keeley Brian dans Les essentiels de l'OCDE Inégalités de revenu : l'écart entre les riches et les pauvres revient là dessus :
Les jeunes issus de milieux défavorisés sont sous-représentés dans l’enseignement supérieur. La composition des effectifs des universités et des établissements d’enseignement supérieur constitue un bon indicateur (...) de nombreux jeunes venant de familles défavorisées se rendent jusqu’à l’université, mais l’influence du milieu social s’y fait alors également sentir. Beaucoup d’entre eux fréquentent des établissements peu réputés, plutôt que les plus côtés ; suivent des formations courtes menant à des diplômes à finalité professionnelle, comme l’ergothérapie, plutôt que des formations longues, comme la médecine ; et enfin sont sous-représentés dans l’enseignement supérieur de haut niveau, notamment dans les programmes de doctorat.
Souvent, les obstacles à l’enseignement supérieur que rencontrent les jeunes gens défavorisés ne tiennent pas à des contraintes d’ordre financier - même si elles jouent certainement un rôle -, mais plutôt au fait qu’ils n’ont pas les bons diplômes (…) l’orientation professionnelle est également importante au secondaire afin que les parents qui ont un faible niveau d’instruction et leurs enfants comprennent bien ce que peut apporter l’enseignement supérieur.
(…) Offrir des possibilités d’enseignement professionnel présente des avantages de plus en plus reconnus, en particulier pour les élèves qui risqueraient autrement d’abandonner l’école. Cependant, trop souvent, seul le milieu social détermine l’orientation vers l’enseignement professionnel. Les enfants, en particulier ceux issus de familles défavorisées, peuvent ainsi être envoyés dans une filière professionnelle dès 10 ou 12 ans, ce qui les prive de tout accès à l’enseignement général à un âge où ils n’ont pas encore pleinement développé leurs centres d’intérêt et leurs aptitudes.
Dominique Odry explique finalement comment une limitation, une sorte de censure, a lieu tant des élèves que des familles ou des institutions. Son étude L'orientation dans le système éducatif. Histoire, logiques et enjeux ( 2021) mentionne que
Les enfants d’ouvriers visent moins haut que les enfants de cadres.
Ce phénomène psychologique de l’autosélection est souvent entériné par les conseils de classe, qui valident la moindre ambition des élèves qui en sont l’objet. D’autres facteurs vont entrer en jeu. La sectorisation des lycées qui ne peut que refléter la composition sociale de leur environnement fait que, outre que l’offre d’options n’est pas identique d’un établissement à un autre, l’implantation des classes préparatoires est très inégalitaire(…) dans les lycées à population favorisée, les professeurs, moins accaparés par la gestion des problèmes quotidiens (problèmes de discipline ou de décrochage), prennent plus le temps pour s’investir dans les questions d’orientation. Ce qui fait que les lycéens n’utilisent pas le dispositif Parcoursu (Ex-APB) de la même façon selon qu’ils sont dans un établissement favorisé ou non. Dans les établissement où les élèves d’origine populaire sont plus nombreux, les familles discutent moins d’orientation, car leurs connaissances des finesses du système sont moins solides : « les lycéens qui reçoivent le moins de conseils dans leur famille quant à leur orientation sont aussi ceux qui, le plus souvent en reçoivent le moins à l’école, ce qui renforce les inégalités ; Et l’aisance des recherches sur Internet, ou bien la facilité d’utilisation des plate-formes d’orientation, la fréquentation des manifestations du type « Salon de l’étudiant », n’est pas la même selon l’origine sociale des parents… »..
On retrouve de semblables inégalités dès lors que l'on aborde la question des parcours scientifiques où les scissions sont profondes et touchent aussi bien les filles que les milieux défavorisés :
En matière d’éducation aux sciences, « Tous égaux devant le sciences » repose sur des dynamiques similaires. Il désigne en effet certaines catégories d’élèves – les filles et les enfants issus des classes populaires – comme accusant un retard en termes d’investissement des filières et professions scientifiques. Si ce constat est bien fondé, les actions mises en œuvre pour y remédier montrent à quel point la sous-représentation de ces catégories est comprise comme la conséquence de « choix » individuels des élèves. Le dispositif étudié propose ainsi d’amener ces derniers à « sortir des sentiers battus » et à « assumer des choix de métiers non-stéréotypés » en faisant « prendre conscience de nouvelles possibilités d’orientation «aux familles défavorisées (…) ces approches reposent sur l’idée que les familles des filles et des élèves n’investissent pas les possibilités d’orientation scientifiques parce qu’elles en ignorent l’existence.Cela suppose de considérer l’école en elle-même comme neutre dans les processus d’orientation scolaire et professionnelle ; les inégalités constatées ne s’expliqueraient que par des choix individuels socialement marqués, une hypothèse largement remise en cause par la sociologie de l’orientation ; L’école – en tant qu’elle est constituée de contextes de socialisation différenciés – joue bien un rôle dans la production des inégalités d’orientation et de réussite.
Source : Émulations n° 29 : Enfances à l'école (2019)
Pour finir, nous vous laissons parcourir le mémoire d'études Le parcours d’orientation : facteurs d’influence et concept de co-éducation. Orientation scolaire : être orienté ou s’orienter, quels sont les effets des déterminismes sociaux et scolaires sur la co-contruction de l’orientation ? de Julie Lapart, Olivia Richard Lepeti, 2018
Ainsi que les ouvrages suivants :
Les labyrinthes de verre: Les trajectoires éducatives en France dans un contexte européen / Collectif, Isabelle Danic, Patricia Loncle, 2022
Les causes de l’échec scolaire évaluées par les enseignants / Jean ravestein, 2019.
Parcours précaires : enquête sur la jeunesse déqualifiée / Philippe Brégeon, 2019




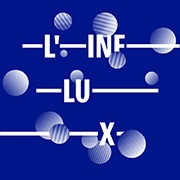 La fabrique quotidienne du décrochage : aux portes...
La fabrique quotidienne du décrochage : aux portes...